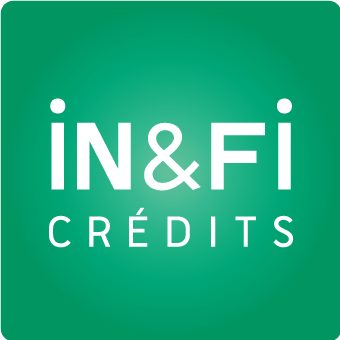Céleste* a 22 ans et est derrière le compte Instagram @payetapsychophobie. “Je l’ai créé il y a un an et demi parce que je me rendais compte que la psychophobie n’était pas du tout connue, déplore-t-elle. Moi, ça m’a aidée que l’on mette un mot sur ce que je ressens. Du coup, je me suis dit que j’arriverais peut-être à toucher d’autres personnes et que cela pourrait faire un peu plus connaître la psychophobie. ”
La psychophobie, qu’est-ce que c’est ?
Ce terme, elle le définit comme “toutes les oppressions que subissent les personnes qui ont des troubles psychologiques ou des neuroatypies” ( troubles du spectre de l’autisme, troubles DYS, etc.). Kamila-Alice, 28 ans, est membre du Collectif Psychophobie et Oppressions Systémiques (POS). Elle précise que la psychophobie est “une forme spécifique de validisme (discrimination envers les personnes handicapées) : elle touche les personnes handicapées psychiques”. Les troubles psychiques sont d’ailleurs la première cause d’invalidité en France. La dimension systémique de ces discriminations, c’est-à-dire le fait qu’elles s’inscrivent dans un système pris dans son ensemble, est important à souligner : on les retrouve au niveau de l’accès à l’emploi, au logement, aux soins, mais aussi sous forme de violence physique, d’injures et de micro-agressions au travers de paroles et de comportements déplacés vis-à-vis de personnes touchées par une maladie mentale ou une neuroatypie.
Un diagnostic long et difficile
L’une des premières difficultés auxquelles les personnes concernées peuvent être confrontées : le diagnostic de leurs troubles. Il est admis par exemple qu’un trouble bipolaire met en moyenne dix ans à être diagnostiqué. Céleste explique que comme elle n’a pas eu de suivi régulier avant ses 19 ans, elle n’a pas eu de diagnostics officiels pour les différents troubles qu’elle suspecte plus ou moins : “Je suis dyslexique et j’ai un trouble du stress post-traumatique, ça c’est sûr. J’ai peut-être aussi la maladie de Pica et un trouble borderline. ” Kamila-Alice affirme de son côté “ne plus se ranger derrière un diagnostic depuis quelques années. J’ai vu différent.e.s psychiatres durant près de 25 ans et chacun.e me donnait un nouveau diagnostic. C’est déstabilisant ! C’est donc difficile de s’apposer une étiquette après en avoir reçu plusieurs. ” Elle explique souffrir “globalement” de troubles de l’humeur et se situe dans le “spectre psychotique”.
La docteure Anne Giersch, psychiatre, directrice de recherche à l’Inserm et membre de la Fondation FondaMental, souligne le fait que la psychiatrie est une discipline jeune par rapport à d’autres spécialités de la médecine, qui fait que cliniquement, les maladies mentales restent mal connues : “Nous n’avons pas de définition claire des diagnostics. C’est la sortie comportementale qui fait le diagnostic. Et certaines pathologies psychiatriques restent difficiles à expliquer. Pour les psychoses par exemple, on sait qu’il y a des éléments organiques qui entrent en jeu. Mais globalement, on ne sait pas bien faire le lien entre les éléments organiques et les symptômes, bien qu’il y ait des hypothèses. Au fond, il faudrait résoudre le problème du lien entre la matière et l’esprit. Et donc on ne sait pas expliquer les troubles psychiques aux patient.e.s, à la famille, au grand public. ”
“Fou” versus “sain d’esprit”
Pour elle, cette incompréhension de la part des chercheur.e.s contribue à la représentation mystérieuse et par conséquent effrayante des maladies mentales : “Ça touche à ce qui nous est propre, c’est-à-dire à notre sens même d’être nous-même. C’est comme une mort psychique – ça fait peur comme la démence, mais la démence on arrive mieux à la comprendre car on sait que c’est une dégénérescence du cerveau. Avec la psychophobie, pour moi, le point essentiel, c’est cette dichotomie que l’on fait entre le ‘normal’ et le ‘pathologique’. ”
Cette stigmatisation du pathologique, Kamila-Alice se souvient l’avoir rencontrée dès son plus jeune âge. “J’étais en décalage avec mes camarades de classe, on m’appellait ‘la folle’ au collège et la psychophobie je l’ai ainsi vécue au travers du harcèlement scolaire. Avec l’âge, on apprend à masquer cette différence pour mieux s’intégrer et on peut paraître presque ‘normale’. Mais lorsqu’une difficulté se présente, les gens en face de vous sont amenés à être confrontés à votre handicap. La psychophobie peut ainsi être très banale et ordinaire dans le cadre des relations familiales ou amicales, parce que l’on sort d’une norme à la fois psychique mais aussi sociale. ”
La membre du Collectif POS se qualifie désormais elle-même de “fol” (nom inclusif de “fou” et “folle”) et fait ainsi partie des personnes qui se réapproprient ce terme, employé de manière péjorative de base, pour affirmer son identité et sa différence. “L’histoire de la folie, pour reprendre le titre du livre de Michel Foucault, est une vieille histoire. Déjà avant l’époque moderne, les personnes malades psychiques étaient assimilées au Mal, voire accusées de possession par le diable. Puis avec l’ère industrielle, il y a eu une exigence accrue de productivité et une injonction au bonheur qui sont venues densifier ce qui appartient à la norme sociale. On bouleverse l’ordre social dès lors que l’on se situe en dehors de la norme psychique établie. La maladie mentale dans ce qu’elle peut incarner vient tendre un miroir effrayant aux yeux de tous de ce qu’il ne faut pas être. ”
Selon elle, socialement, “les maladies mentales sont mal connues et stigmatisées parce qu’avant tout personne ne veut être malade mental. Cela fait peur, et chacun sait a minima que c’est un état qui nous met en difficulté. ” Ce sur quoi s’accorde Kassatca*, 35 ans, également membre du Collectif POS, usagère de la psychiatrie et ancienne infirmière en psychiatrie, qui souligne le côté “scientiste” de la société actuelle : “celle-ci met au cœur de ses principes le rationalisme. Par ‘scientiste’, on ne veut pas dire ‘scientifique’, mais qui valorise une certaine caricature de la science au détriment de tous les autres modes de réflexion. La catégorisation ‘fou VS sain d’esprit’ est d’une importance majeure dans l’image que l’on se fait d’autrui. ”
Psychiatrisation de la société
Dire “t’es fou/folle” à une personne qui ne partage pas le même avis que nous, “t’es bipolaire” à quelqu’un qui est d’humeur changeante, “t’es schizo” à quelqu’un dont on ne comprend pas les choix… Cette tendance à tout psychiatriser est problématique à bien des égards : “C’est très gênant car la folie est utilisée comme une insulte, remarque la Dre Giersch. Cela témoigne de la stigmatisation des maladies mentales et de la représentation collective qu’on en a. ” “La psychiatrisation est utilisée comme une attaque, un argument bas de gamme, abonde Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne. C’est une façon de mettre à l’écart du débat, de stigmatiser une fois de plus. ”
“J’ai le sentiment que psychiatriser, c’est critiquer plus fortement, explique de son côté Agathe, 41 ans, bipolaire et membre de l’association Comme des fous. Comme si le fait que cela relève d’une maladie psychique soit plus grave que le comportement en lui-même. On voit bien là cette idée de culpabilité, de faute des personnes concernées par des troubles psychiques. Pathologiser devrait excuser, et là ça accuse…”
“Être malade psychique, c’est nécessairement, dans la bouche et dans le regard d’autrui, appartenir au néfaste, ajoute Kamila-Alice. La folie sert à invoquer le péjoratif. Lorsqu’on dit que Donald Trump est fou par exemple, on pathologise la politique et cela a un effet bien plus néfaste dans la mesure où cela revient à la dépolitiser. Or il n’y a pas besoin de souffrir d’une maladie mentale pour mener une politique ultralibérale et oppressive. ” “C’est psychophobe parce que c’est encore une façon de reléguer des comportements inacceptables dans la catégorie des malades mentaux, donc on nous assimile à des attitudes de domination alors que, statistiquement, les personnes qui ont une maladie mentale sont plus souvent agressées qu’agressives, et sont sous-représentées à des postes de pouvoir ou de prestige”, rebondit Kassatca.
Accès à l’emploi : “on souffre du stigma d’être peu fiables”
Celles-ci auraient en effet 11 à 13 fois plus de risques d’être victimes de violences physiques. Toutes ces idées reçues et représentations de la maladie mentale dans l’inconscient collectif ont donc un impact direct sur leur vie quotidienne, et notamment leur vie professionnelle ou étudiante. On estime que 70 à 80% des personnes avec des troubles psychiatriques graves n’ont pas accès à l’emploi. “Il faut néanmoins faire la différence entre les psychoses où la vie quotidienne est objectivement entravée et les psychoses avec lesquelles on peut vivre relativement normalement”, tempère la Dre Giersch. Mais lorsque ces personnes y ont accès, il n’est pas des plus adaptés : “Certains patients ont besoin d’aménagement dans leur emploi du temps et doivent parfois faire face à des périodes plus compliquées que d’autres. Tout cela peut créer du scepticisme quant à leur capacité à gérer sur le long terme un travail par exemple”, remarque Johanna Rozenblum.
Kamila-Alice le confirme car elle l’a vécu : “l’accès à l’emploi n’est pas facilité et on ne parle pas de son handicap psychique parce qu’on souffre du stigma d’être peu fiables, instables lorsqu’on est bipolaire voire fainéants si l’on souffre d’une dépression chronique. Il peut s’avérer difficile de faire respecter certains besoins et il est courant de ne pas demander des aménagements pour ne pas subir de la psychophobie. Or c’est essentiel pour garder un emploi et éviter de souffrir trop vite d’un burn out. ”
Agathe par exemple n’a pas parlé de son handicap avant ses 30 ans. “Lorsque je l’ai fait, c’était dans le but de devenir titulaire dans la fonction publique. A cette annonce, alors que tout se passait bien, je me suis retrouvée placardisée, presque ostracisée. Je me suis alors dit que j’allais l’annoncer avant les recrutements pour tomber dans des univers plus accueillants. Mais là aussi, les interrogatoires sur la nature de mon handicap – qui sont en plus illégaux – ont réussi à me faire partir. La souffrance psychique est d’autant plus difficile à gérer qu’il s’agit d’un handicap invisible et l’on va souvent être scruté.e.s pour percevoir ce qui ‘cloche’ chez nous. ”
Les aménagements qui peuvent être mis en place (mi-temps thérapeutique, ajustement des horaires, travail en autonomie ou en équipe privilégié…) sont difficilement obtenus. Et même lorsqu’ils le sont, la lutte n’est pas terminée. Comme beaucoup de personnes avec des troubles mentaux, Céleste est plus rapidement fatigable que les autres (à cause des traitements ou du trouble en lui-même). Dans son école, elle bénéficie d’un tiers temps pendant ses examens. “Mes profs ont été prévenus du risque que je m’endorme en cours. Malgré ça, j’ai souvent des remarques de la part de certains d’entre eux. Pour mon stage, j’ai demandé à avoir des horaires plus légers, mais je ne les ai pas obtenus. ” Elle a demandé une reconnaissance de handicap en Belgique, où elle habite. “En France, c’est long, mais en Belgique, ça l’est encore plus. Avant le Covid, c’était déjà un an d’attente. Mais là, à mon avis, je vais devoir attendre un an et demi avant d’avoir une réponse. ”
Logement : “difficile d’en trouver et de le garder”
Ces difficultés d’insertion professionnelle entraînent une pauvreté qui, inévitablement, rend aussi difficile l’accès au logement. On estime qu’une personne sans domicile fixe sur trois souffre de troubles psychiatriques graves : “cela est en partie relatif à la vie dans la rue et à l’instabilité de se retrouver sans logement, mais on retrouve également beaucoup de personnes psychiatrisées au sein de cette population, tient à souligner Kamila-Alice. Et comme pour toute personne handicapée percevant l’allocation aux adultes handicapés (AAH), il est difficile de trouver un logement décent puis de le garder, comme cela l’est de garder un travail. ”
“Les bailleurs publics et les maires restent des obstacles majeurs pour les associations qui peinent à trouver des logements pour ce ‘public’ réputé difficile que sont les personnes souffrant d’un handicap psychique, ajoute Agathe. Les loyers importants et les conditions de revenus qui font apparaître des allocations handicap laissent souvent les bailleurs privés tout aussi frileux. ”
L’accès aux soins non psychiatriques compliqué
Kamila-Alice note que la discrimination envers les personnes avec des troubles mentaux se retrouve également dans le cadre de soins non psychiatriques. “On peine à être pris.e.s au sérieux lorsqu’on exprime des douleurs ou un problème de santé, notamment pour les personnes psychotiques où une douleur serait délirée – elle peut être mal verbalisée ou de manière fantasque, mais elle doit être écoutée. ” Dans la logique d’une psychiatrisation de la société, la membre du Collectif POS observe également “une tendance à mettre sur le compte de l’anxiété et de la dépression certains symptômes, ce qui retarde le diagnostic de maladies chroniques comme la maladie de Crohn pour des douleurs au ventre, le syndrome d’Ehlers-Danlos pour une souffrance corporelle généralisée…”
Auto-stigmatisation et retard de prise en charge
Les conséquences de ce système pensé par et pour les personnes valides psychiquement : une auto-stigmatisation de la part des personnes souffrant de troubles mentaux. Avec un impact sur leur prise en charge. “En France la santé mentale est encore très stigmatisée et les aides à l’insertion sociale compliquées. Tout ceci n’aide pas les patients dans leur travail d’acceptation de leur traitement ou de leur maladie. Ils ne parlent pas de leurs problèmes, se replient et se résignent”, constate Johanna Rozenblum.
Les personnes concernées parlent d’une atteinte destructrice à l’estime de soi. “Il est difficile de s’aimer lorsque ce qui nous affecte est associé au meurtre par exemple, je pense notamment à la schizophrénie qui souffre du lourd stigma de la dangerosité, note Kamila-Alice. Et cela amène les personnes malades psychiques à s’isoler. ” “Cela entraîne une restriction de l’accès aux soins, précise Kassatca. Quand votre maladie est socialement ostracisée, vous allez avoir plus de risques de rejeter le diagnostic et donc toute possibilité de soin. Il y a beaucoup d’autres raisons pour lesquelles on peut refuser les soins psychiatriques, mais l’auto-exclusion par intériorisation du stigmate, ça ne permet pas de prendre des décisions en toute connaissance de cause. ” Et Agathe de s’interroger : “Comment avoir confiance en soi et se mobiliser pour soi et pour les autres quand on est rejeté voire écrasé ?”
Pour Céleste aussi, l’impact de la psychophobie est tangible. Elle explique avoir mis du temps à consulter un psy à cause des préjugés qui y sont associés. “Je pensais que la consultation chez un psychologue était pour les gens qui allaient vraiment très mal, mais c’est faux. On peut juste se sentir un peu moins bien que d’habitude et en parler à une personne neutre. Et du coup, il y a déjà tout ce retard que les gens prennent, parce qu’ils ont tendance à se laisser vraiment sombrer, être au fond du trou avant de consulter. ” Johanna Rozenblum déplore cette image du psy “pour les fous”. “C’est une méconnaissance du travail de psychologue et de la santé psychique que de formuler une telle phrase. Lorsqu’on va voir un psychologue c’est pour comprendre, élaborer autour de sa pensée, mettre en place des outils qui permettront de restaurer une forme de bien-être. C’est travailler à mieux se connaître, à accepter, à verbaliser autour de ses émotions…”
Céleste remarque que c’est encore plus compliqué pour la psychiatrie, qui souffre d’une image encore plus péjorative “alors qu’au fond, c’est un service comme un autre. Il n’y a pas de honte à être hospitalisé. Il vaut mieux le faire que de rester avec ses difficultés. ”
Prise en charge : “il y a une méconnaissance autour des traitements psy”
La prise en charge et les traitements des troubles psychiques ont d’ailleurs eux-mêmes contribué à cette psychophobie. Incompris, ils ont fait l’objet d’expérimentations déshumanisantes, gravées dans notre inconscient collectif : contention par des chaînes, camisole de force, électrochocs sans anesthésie générale… Et malgré les avancées notamment au niveau des traitements médicamenteux et des suivis ambulatoires, “les représentations de la folie sont restées aussi importantes qu’il y a 50 ans, estime Agathe. La société n’a pas encore perçu ce changement qui fait que les personnes concernées par des troubles psychiques peuvent mener leur vie pas forcément comme tout le monde mais presque, et qu’un psychotique des années 1950 n’est pas une personne suivie pour psychose des années 2020. ”
Il n’empêche que d’énormes progrès restent à faire en psychiatrie, considérée comme le parent pauvre de la médecine. “Elle peine à suivre l’évolution des personnes qu’elle suit et grève encore trop les destins positifs par manque de volonté des pouvoirs publics de s’y intéresser et d’y investir”, affirme Agathe. Kassatca dénonce la “méconnaissance autour des traitements psy”, les maladies mentales n’étant “pas vues comme relevant réellement de la santé : on les considère généralement comme des composantes morales de la personnalité. On imagine qu’on peut se soigner par la seule force de la volonté. Il y a aussi des représentations assez romantiques de certaines maladies, qui seraient des états sacrés, spirituels ou permettant la création artistique, empêchée par les traitements. C’est une forme de négation de la souffrance psychique. ”
Les membres du Collectif POS dénoncent ainsi des injonctions contradictoires : d’un côté, “il est mal vu de prendre un traitement en rapport avec une maladie mentale car cela réduirait la vraie personnalité de la personne”, certains traitements ayant pour effet “d’émousser, de lisser les émotions pour éviter les états dépressifs ou maniaques”. “Or, cela ne nous viendrait pas à l’esprit de critiquer le traitement que doit prendre une personne asthmatique, diabétique ou cardiaque”, compare Kamila-Alice. De l’autre, “une personne psychotique recevra toujours cette injonction à se médicamenter. On nous offre trop peu cette alternative de vivre avec notre trouble plutôt que de nous en couper comme si cela ne devait pas exister. Mes hallucinations me disent toujours quelque chose de mon état émotionnel, je vis mal d’en être coupée car c’est être coupée de moi-même. ” “Il est possible en effet d’apprendre à vivre avec ses hallucinations, et c’est une approche actuellement développée, mais ce n’est pas applicable à tous les patients, rebondit la Dre Giersch. Pour certains, les hallucinations sont une douleur psychique. ”
Listes de psys ‘safe’ : “les soignants doivent se former sur les oppressions systémiques”
Le coût des consultations chez un.e psy constitue également une entrave à une bonne prise en charge. Céleste voit sa psychiatre toutes les deux semaines, mais “s’il y avait une meilleure accessibilité”, elle pourrait avoir un suivi psychologique hebdomadaire à côté. Elle s’estime néanmoins chanceuse : “Je suis avec une personne qui me correspond, qui m’a donné un traitement adapté, qui me permet d’évoluer positivement. Mais je sais que vu le nombre de témoignages que je poste sur mon compte Instagram, il y a certains psychiatres qui ne sont pas aussi bienveillants. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai publié des listes ‘safe’ à compléter : pour que les gens évitent, en plus d’être mal, de tomber sur quelqu’un qui n’est pas à leur écoute. ”
L’annexe du Collectif POS, SOS Psychophobie, propose également une liste de praticien.nes en santé mentale. “Cette liste existe parce qu’il est nécessaire lorsqu’on vit une oppression systémique de ne pas la subir dans le cadre d’un suivi, explique Kamila-Alice. C’est compliqué d’être dans une démarche de soin et d’aller mieux lorsque la personne en face en charge de vous soigner est potentiellement transphobe par exemple. La liste a été créée pour permettre à des personnes d’avoir un suivi optimal et dans le respect de ce qu’elles sont. ” Pour améliorer la prise en charge des personnes avec des troubles psychiques, Kassatca estime ainsi que “les soignants doivent se former sur les oppressions systémiques (psychophobie, racisme, sexisme, homophobie, etc.). Il y a actuellement des mouvements militants féministes, antiracistes, anti-grossophobie, etc., portés par les premiers concernés qui dénoncent les maltraitances médicales, statistiques à l’appui. C’est d’une importance majeure. ”
Lutte contre la psychophobie
Développer une politique d’éducation
Quelles autres solutions pérennes peut-on envisager pour mettre fin aux discriminations envers les personnes souffrant de troubles psychiques et mieux les insérer dans la société ? D’abord, une véritable politique d’éducation au sujet de la santé mentale. Céleste remarque que bien qu’elle fasse des études de psychologie, ses camarades ont “du mal à comprendre, à savoir comment réagir face à [elle]. Parce que dans notre société, on n’est pas éduqué à ça, on ne sait pas comment faire avec les gens qui sortent de la norme, et moi-même avant d’être concernée je n’aurais pas su comment réagir. J’aurais peut-être aussi eu un regard assez négatif. ”
Selon une étude menée par Ipsos pour la Fondation FondaMental, la moitié de la population française se sentirait gênée de vivre sous le même toit qu’une personne atteinte d’une maladie mentale et un tiers n’aimerait pas travailler (35%) ni même partager un repas (30%) avec elle. “Il y a tout un travail de prévention et d’information à réaliser dès le plus jeune âge et au sein de diverses structures, et notamment au sein du milieu médical, suggère Kamila-Alice. Nous nous efforçons d’aller dans ce sens et de mener un travail de sensibilisation par des visuels et la critique de contenu psychophobe. Il me paraît urgent de lutter contre des représentations fictives dévalorisantes et éloignées de la réalité. ”
Toutes déplorent en effet la représentation négative des maladies mentales, notamment dans les médias. “On voit toujours les personnes qui commettent des actes criminels, qui sont dans des hôpitaux psychiatriques qui ressemblent à des asiles des années 1950, ou qui sont dans des états vraiment critiques et complètement déconnectés de la réalité, remarque Céleste. On ne voit jamais celles qui sont malades, mais qui arrivent à gérer leur vie. ” “Les troubles psychiques doivent sortir du sensationnalisme de l’image médiatique pour intégrer la parole et le discours publics. La sensibilisation du grand public par l’art, le cinéma et la littérature sont également des leviers importants à saisir”, abonde Agathe.
Donner la parole aux concerné.e.s
En ce sens, l’association Comme des fous cherche à “changer les regards sur la folie” en “redonnant la parole à ceux qui sont concernés, pour démontrer leurs capacités à fonctionner intellectuellement et socialement. Cette démarche vise à montrer qu’un rétablissement est possible et que les malades psychiques sont des citoyens comme les autres qui peuvent mener une existence intéressante. Il s’agit de porter cette parole des ‘fous’, qui ne le sont plus vraiment, au grand public pour déstigmatiser et faire connaître. ” Même combat pour le Collectif POS, qui souhaite “permettre la solidarité entre psychophobisé.e.s, valoriser la pair-aidance et l’expérience des personnes survivantes et qui ont trouvé le chemin du rétablissement. Des techniques sont développées par les personnes concernées, un discours s’est élaboré et il est essentiel de l’intégrer. On ne peut plus se contenter de baser le soin sur un échange avec une personne extérieure à ces états et le limiter à des traitements. ”
Un meilleur accompagnement médico-social
Pour la Dre Giersch aussi, les médicaments ne sont pas la seule et unique solution. “Il doit y avoir un meilleur accompagnement médico-social : il faut leur ouvrir les portes, les assistant.e.s sociaux.ales sont là pour eux, pour vérifier les problèmes de logement et proposer éventuellement un logement thérapeutique, pour qu’ils aient accès à l’AAH, leur ouvrir les portes des centres d’aide par le travail (CAT)… Trouver des solutions pour qu’ils puissent s’insérer au mieux. ” Pour Agathe, la psychophobie au travail est l’un des plus grands enjeux : “Il va falloir trouver des voies d’insertion des personnes concernées et éviter le rejet des salariés en détresse. Certains pays voient de grandes entreprises s’afficher ouvertement ‘mental health friendly’ [adaptées aux personnes avec des troubles mentaux, NDLR]. ” La membre de Comme des fous, également cofondatrice de la coopérative de travailleurs pair-aidants en santé mentale Pairiscoop, affirme qu’elle ne voit “pas d’autre environnement possible que les marges de la société pour évoluer sans se cacher. Ce que je fais aujourd’hui me permet d’être moi, de ne plus me faire des nœuds au cerveau par rapport à la perception potentielle de mes troubles par l’entourage. ”
Mieux défendre leurs droits
Agathe encourage également les personnes qui souffrent de troubles psychiques à réagir en cas d’abus ou de maltraitance à l’hôpital : “des organisations défendent leurs droits comme le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA) ou certains avocats spécialisés. La saisie de la justice sur les questions de maltraitance à l’hôpital doit se développer et finir par aboutir à ce qu’on voit pour les prisons : des indemnisations pour les victimes. C’est pour cette raison que les collectifs d’usagers et de proches sont indispensables. ”
Le rôle des psys et des chercheur.e.s
Les psys et les chercheur.e.s auraient également un rôle à jouer dans la sensibilisation aux maladies mentales et plus largement à la santé mentale. “Certainement que nous avons une responsabilité dans la pédagogie grand public, assure Johanna Rozenblum. Je pense que l’année que nous venons de passer avec la crise sanitaire liée au Covid-19 nous a tous fait réaliser que la santé mentale fait partie, au même titre que la santé physique, de notre santé. ”
Ce sur quoi s’accorde la Dre Giersch, mais selon elle, on aurait pu aller plus loin : “Pendant les confinements, j’ai été frappée par le fait qu’on parle du stress, de l’anxiété, de la dépression, mais presque jamais de la psychose. Pourtant, les hallucinations par exemple, ça fait partie des symptômes dont on a le droit de parler. ” La psychiatre a participé à une étude sur les symptômes atténués de la psychose pendant le confinement. “En début de confinement, 20% de nos participants ont répondu aux critères de prodromes de la psychose, des individus qui étaient considérés comme sains. D’autres expériences ont montré que dans des conditions où il y a des privations sensorielles, les participants développent des hallucinations. ” Selon elle, cela montre que les hallucinations doivent être dédramatisées : “dans l’imaginaire collectif, les hallucinations, c’est la folie. Mais on peut également les retrouver dans les maladies neurologiques, ou chez tout le monde dans des conditions particulières certes, mais cela relativise l’idée que la folie est un état qui se distingue entièrement de notre état au quotidien. ”
La psychiatre déplore une “autocensure” au sujet des maladies mentales. “Il faut qu’on arrive à trouver, et je me fais le reproche à moi-même, les mots pour parler de ces symptômes qui font peur, d’essayer de les déstigmatiser. Ce que je vois comme limite, c’est le fait qu’on n’arrive pas encore à les expliquer complètement. Le jour où l’on aura une explication rationnelle, ce sera plus facile. ” Néanmoins, elle souhaite faire savoir que la recherche avance à ce sujet “et que l’on se préoccupe de ces patients et de leur famille”. Agathe le précise aussi : “Aujourd’hui, il existe des chercheurs concernés par des troubles psychiques qui travaillent en sciences humaines sur la santé mentale, des patients experts dans les hôpitaux pour de la formation et de l’accompagnement des professionnels et des pairs. Tout ceci doit être communiqué au grand public. ”
“On existe, on n’est pas seul.e.s”
Que ce soit l’association Comme des fous, le Collectif POS ou Céleste au travers de son compte Instagram, tous.tes insistent : les personnes avec des troubles psychiques ne sont pas seules. “Rester isolé.e peut sembler être un bon réflexe pour cesser de subir autrui dans sa psychophobie mais des alternatives dont nous n’avons pas conscience et que des pairs peuvent partager existent, explique Kamila-Alice. Il ne faut pas hésiter à s’informer et à aller toquer à des portes d’associations ou de collectifs, pour demander de l’aide. Il existe également beaucoup de groupes de soutien en ligne désormais, que ce soit sur Facebook ou ailleurs. ” “On passe souvent des années à se flageller et à culpabiliser d’être ce qu’on est, avant de rencontrer des gens comme nous”, ajoute Kassatca. Et Céleste de conclure : “On est beaucoup plus nombreux qu’on ne le pense. On existe, on n’est pas seul.e.s. Ne tardons pas à nous faire aider. N’ayons pas honte d’être hospitalisé.e.s. Parlons et normalisons tout cela ».
Source DOCTOSSIMO.











![Le manque de sommeil peut avoir des conséquences sur la santé [photo d'illustration]. Le manque de sommeil peut avoir des conséquences sur la santé [photo d'illustration].](https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2021/04/1caf2874-1f76-4bd8-94f3-48a989eff2e8/870x489_maxstockworld403738.jpg)