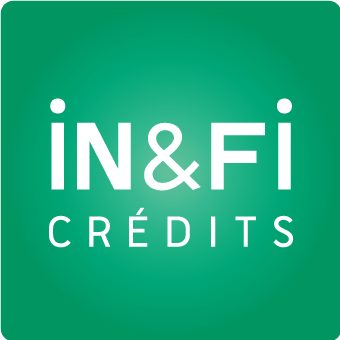« J’aimerais tant refaire la queue en caisse pendant des heures, courir, jardiner, rester debout dans les transports en commun… » regrette Mokhtaria.

HANDICAP — Quésaco la spondylarthrite? Nom inexistant dans mon imaginaire et vocable, je découvre à mes 33 ans cette maladie invisible et handicapante au quotidien. De quoi s’agit-il? La spondylarthrite appelée dans le jargon médical SPA est une maladie auto-immune et rhumatismale, touchant principalement les articulations sacro-iliaques et s’accompagnant d’inflammations.
Elle se déclenche chez l’adulte jeune (20/30 ans) et touche davantage les hommes que les femmes. Cette définition peut paraître générale, abstraite, voire incompréhensible.
Pour expliciter mes propos, je souhaite parler de ma SPA; car il existe différentes manifestations, différentes douleurs, différents traitements. La SPA est propre à chaque personne.
Vous avez envie de raconter votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez briser un tabou? Vous pouvez envoyer votre témoignage à temoignage@huffpost.fr et consulter tous les témoignages que nous avons publiés. Pour savoir comment proposer votre témoignage, suivez ce guide!
La maladie déclarée jeune
Ma SPA est apparue à mes 32 ans, se caractérisant par des douleurs au bas du dos et aux hanches, une raideur aux doigts. Premier signe apparent, une arthrose des hanches dite coxarthrose. À mon jeune âge, ce n’est pas possible me dis-je. Pourtant, c’est bel et bien le cas, car l’arthrose peut se déclarer à tout âge. Par la suite, les semaines s’écoulent avec ces douleurs fluctuantes. Je suis orientée vers la rhumatologie. Oui, la rhumatologie à 32 ans, moi qui pensais que cette spécialité médicale était réservée davantage à nos aînés. Je continue de gérer ces maux; qui s’estomperont au fil du temps. Or, ce n’est pas le cas.
Mon corps a de plus en plus mal, est de plus en plus fatigué. Un matin, je n’arrive plus à me lever. Je consulte, en urgence, une rhumatologue. Je suis, dans la foulée, hospitalisée dans un service de rhumatologie ne posant pas de diagnostic médical. Je consulte d’autres rhumatologues, l’une me prescrivant un traitement pour la fibromyalgie, l’autre effectuant six injections au bas de mon dos. Mon médecin traitant (que je ne remercierai jamais assez pour son professionnalisme, son écoute et sa bienveillance) m’oriente vers la spécialité médecine interne.
Enfin de la lumière au bout du tunnel. Je suis consultée, entendue et comprise par un professeur émérite. Mon mal invisible se caractérise par un déverrouillage matinal du corps, des inflammations et des douleurs au bas du dos, aux hanches, une fatigue et une sensation de lourdeurs aux jambes. Après des examens médicaux, le diagnostic tombe: je suis atteinte d’une spondylarthrite. Une quoi? Une sp… dont je n’arrive pas à prononcer le nom, au début. OK, j’ai cette m… avec tout ce que cela implique.
Maintenant, je dois ou plutôt je vais essayer de vivre, survivre ou revivre avec cette maladie au nom complexe. J’ai une chance de bénéficier de soins de qualité, avec des professionnels de santé tip-top. Mes traitements visent à atténuer les douleurs et ralentir la progression de la maladie.
Aujourd’hui, j’ai 37 ans. Je tente de gérer au mieux ma SPA. Elle et moi cohabitons depuis 5 ans, avec des moments où elle l’emporte sur mon corps et mon esprit et d’autres moments, où je la terrasse. Le verbe peut paraître excessif. Pourtant, c’est bel et bien le cas, car la SPA se vit au quotidien.
Une maladie invisible qui se combat au quotidien
Chaque jour est une douleur invisible, dont l’intensité varie et le moral est mis à épreuve. Je bénéficie d’une reconnaissance MDPH et de la carte mobilité inclusion. Cette carte a pour but de faciliter mes déplacements. Je peux solliciter une place dans les transports en commun ou dans une salle d’attente, éviter la file d’attente dans les établissements recevant du public.
Pourtant, cette carte priorité semble incomprise pour de nombreuses personnes. Je l’utilise principalement en magasin, où est signalée caisse priorité. Drame, qu’ai-je fait en sollicitant cette priorité? Les gens vous scrutent, se permettent des commentaires, réfutent cette priorité. J’ai entendu, de nombreuses fois, ces phrases: ”À son âge, on n’est pas malade”,” La MDPH donne la carte à n’importe qui”, “Celle-là fait semblant pour ne pas faire la queue”.
J’ai, longtemps, été mal à l’aise avec l’utilisation de cette carte. J’ai dû, à plusieurs reprises, justifier cette priorité. Ceci s’explique par les propos inappropriés, désobligeants de certaines personnes que j’ai reçus. Ma maladie, mon handicap leur apparaissent invisibles. Les individus ont une perception du handicap se caractérisant par un élément visible de type fauteuil roulant ou canne. Or, il existe des handicaps non apparents, avec de lourds retentissements.
«J’ai entendu, de nombreuses fois, ces phrases: ‘À son âge, on n’est pas malade’, ‘La MDPH donne la carte à n’importe qui’, ‘Celle-là fait semblant pour ne pas faire la queue’.»
– Mokhtaria M.
À tous ces gens portant un jugement, je souhaite leur dire « Cessez !!!! Je vous remets cette priorité avec toutes les douleurs et les pleurs que cela comporte ». Cette carte ne sert qu’à m’aider dans mon handicap.
J’aimerais tant refaire la queue en caisse et pendant des heures, courir ne serait-ce qu’un kilomètre, jardiner un quart d’heure, rester debout dans les transports en commun, réaliser mes tâches ménagères sans aide quelconque, sauter à la corde à sauter avec mon enfant, porter des courses sans aucune douleur déclenchée…
Cela voudrait dire tout simplement que ma santé est bonne.
Source Huffingtonpost.