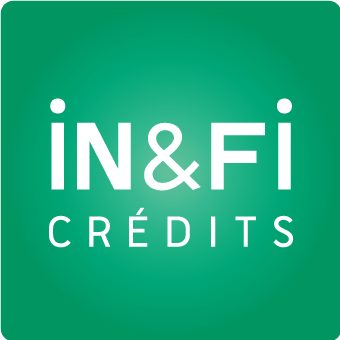Leur corps paraît en bonne santé, elles sont pourtant pétries de douleurs.
Porteuses d’un « handicap invisible » des millions de personnes mènent au quotidien un double combat : faire face à la maladie, mais aussi être reconnues par la société.

Lorsque l’on parle de handicap, on pense immédiatement (et naïvement) aux seules personnes en fauteuil roulant. Mais saviez-vous que 80% des handicaps sont en réalité « invisibles » ? À l’échelle de la France, cela représente 9 millions de personnes, selon l’association APF France Handicap.
Le handicap invisible est une appellation regroupant plusieurs maladies. Il peut s’agir de maladies invalidantes, chroniques ou non, comme le diabète, l’endométriose ou le cancer, mais cela peut aussi concerner certaines maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, ou encore des troubles comme le syndrome d’Asperger, l’hyperactivité, la dyslexie ou la dyspraxie, les suites d’un accident vasculaire cérébral ou d’une rupture d’anévrisme, la bipolarité, etc. Une liste bien évidemment non exhaustive tant elle serait trop longue à détailler.
Le handicap invisible recouvre donc des réalités très diverses, ayant pour seul point commun de ne pas être détectables à l’œil nu. Une particularité qui fait du quotidien des malades un véritable défi.
Contraintes, douleurs et charge mentale imperceptibles
Même s’il ne se voit pas, le handicap n’en demeure pas moins invalidant. Les malades souffrent de diverses affections et doivent composer avec les conséquences de la maladie dans un quotidien qui n’est pas toujours adapté à leurs maux.
C’est le cas de Sophie, 47 ans, atteinte d’une otospongiose bilatérale, une maladie extrêmement rare qui touche l’oreille interne. Sophie n’entend pas très bien et souffre d’acouphènes, de jour comme de nuit. Son audition a chuté au fil du temps, mis plus particulièrement après ses deux grossesses. « Je dois perpétuellement préciser à mes interlocuteurs que je suis malentendante. J’ai du mal à m’adapter dans les milieux bruyants, car je ne parviens pas à isoler les bruits, il m’est difficile d’échanger avec plusieurs personnes en même temps », nous explique-t-elle.
À 28 ans, Astrid* est atteinte de spondylarthrite ankylosante et de rhumatisme psoriasique, deux pathologies lourdes. Sa première affection est une maladie rhumatismale qui atteint surtout la colonne vertébrale et le bas du dos. Elle se traduit par des douleurs et une perte de souplesse des articulations.
Il s’agit d’une maladie chronique et évolutive, qui conduit à une raideur progressive des articulations. À terme, les vertèbres peuvent même se souder, provoquant alors une rigidité prononcée de la colonne vertébrale. Le rhumatisme psoriasique se traduit quant à lui, par une inflammation des articulations à l’origine de douleurs et de raideurs, associées à de la fatigue.
Seuls des traitements de confort (à base d’antidouleurs puissants), des traitements de fond pour freiner les inflammations et les atteintes des tissus articulaires (anti-inflammatoires et immunosuppresseurs), ainsi que des séances de kinésithérapie, ont pu lui être prescrits afin de limiter ses douleurs. « Ce sont des traitements lourds et fatigants. Malgré l’arrêt des anti-inflammatoires aujourd’hui, la fatigue est toujours là et les douleurs vont et viennent au gré de mes activités », détaille Astrid.
Les douleurs ne sont pas faciles à gérer au quotidien et rendent les moindres tâches compliquées pour la jeune femme : passer l’aspirateur, rester debout plus d’une heure… relèvent selon les jours de l’exploit. « Je ne peux jamais prévoir quand j’aurai mal, déplore-t-elle. Les durées des crises peuvent être plus ou moins longues, pouvant aller jusqu’à m’empêcher de marcher correctement. J’ai aussi beaucoup de maux de tête à cause de douleurs cervicales, du psoriasis, et je cumule beaucoup de fatigue. » Ses temps d’activités sont limités et précèdent toujours un temps de repos, nécessaire à sa récupération.
« On m’a indiqué que c’était une maladie dont je ne guérirai pas et pour laquelle il n’y avait pas de traitement. »
De son côté, Julia*, 34 ans, est atteinte de diabète depuis 20 ans. Une maladie contraignante et invalidante rythmée par les variations de son taux de sucre dans le sang. Elle doit en permanence surveiller ce dernier et s’injecter de l’insuline pour compenser le travail que n’effectue plus son pancréas. De l’extérieur, on ne soupçonne absolument pas sa maladie et le traitement qu’elle impose.
Pendant plusieurs années, elle est contrainte de s’isoler aux toilettes ou dans une pièce vide pour prendre son traitement. « Je ne me voyais pas en parler ouvertement et ‘imposer’ en quelque sorte ma maladie en faisant mes piqûres devant des gens par exemple. » Les progrès de la médecine aidant, elle peut désormais se soigner en toute discrétion. « Aujourd’hui, je peux assister à une réunion ou me balader dans l’open space tout en contrôlant ma glycémie ou en m’injectant de l’insuline sans que personne autour de moi ne soupçonne rien ». Des évolutions qui ont évidemment amélioré le quotidien de Julia et sa gestion de la maladie, mais qui l’invisibilise finalement davantage.
À cause des variations parfois incontrôlables de son taux de sucre, le diabète entraîne chez elle beaucoup de fatigue et de déconcentration. « Lorsque je fais des hypoglycémies la nuit, je suis toujours un peu dans les vapes le lendemain, car mon cerveau a manqué de sucre parfois pendant plusieurs heures. Quand j’en fais au travail, il me faut aussi un petit temps de récupération. Ce n’est pas toujours simple à gérer et il est difficile d’être proactive dans ces conditions », regrette-t-elle. « Il y a aussi toujours ce stress de faire une hypoglycémie au mauvais moment. C’est une vraie charge mentale. »
Faire face aux préjugés et discriminations
Aujourd’hui plus que jamais, les mots « intégration » et « égalité des chances » résonnent comme des gageures dans une société qui se revendique équitable et tolérante. Si l’on sait que la réalité est loin d’être à la hauteur, d’autant plus lorsque les différences sont visibles, qu’en est-il lorsqu’il s’agit d’un handicap invisible ?
« Beaucoup de malades se disent victimes de préjugés ou de discriminations en raison de l’invisibilité de leur handicap », remarque Patrice Tripoteau, Directeur général adjoint de l’APF France Handicap. « L’image que la société renvoie de l’individu est celle d’une personne sans problème, ni maladie, et dont les difficultés de fonctionnement seraient corrigibles par la simple volonté. »
Comme Sophie n’entend pas forcément lorsque l’on s’adresse à elle, certaines personnes deviennent agressives envers elle dans les magasins. « Si je ne me pousse pas assez rapidement, comme mon handicap n’est pas total et qu’il ne se voit pas, les gens ne comprennent pas et lorsque je précise que je suis malentendante, beaucoup pense que je me moque d’eux. J’ai l’impression de devoir me justifier en permanence. Certaines personnes ne veulent pas comprendre, s’agacent lorsque je demande de répéter une phrase ou me font des remarques désobligeantes, comme : ‘Tu n’as rien prévu pour améliorer les choses’, ‘Tu vas te faire ré-opérer ?’ ou encore ‘Ton appareil fonctionne mal aujourd’hui ?' ». Des phrases qui, à la longue, blessent Sophie profondément.
« J’ai parfois souvent eu la sensation que certaines personnes pensaient que je mentais ou que j’exagérais. »
Astrid a fait de nombreuses fois l’objet de discriminations. Dans le cadre de l’achat de sa maison par exemple, elle et son conjoint ont dû déposer environ 12 dossiers auprès d’assureurs, avec l’aide d’un courtier, impuissant face aux refus qui s’enchainaient. « C’était l’enfer et j’étais très en colère. À chaque dossier que je faisais, je devais fournir un questionnaire de santé (tous différents pour chaque assureur) rempli par mon médecin ou ma rhumatologue, mais aussi fournir tous les comptes rendus d’examens et les traitements en cours ou à venir. J’y ai passé deux mois. Finalement, j’ai trouvé une assurance moi-même, en fouillant sur Internet et sur les réseaux sociaux auprès de groupes de patients pour trouver une assurance qui accepte mon dossier. Cette dernière avait publié un communiqué de presse datant de 2015 dans lequel elle indiquait offrir des modalités d’assurance assouplies pour les patients atteints de rhumatismes inflammatoires. Avec le courtier, nous avons saisi ce dernier espoir et mon dossier est enfin passé. »
La jeune femme a elle aussi l’impression de devoir sans cesse justifier être réellement malade. « J’ai le sentiment de devoir donner des explications quant à mon état pour que l’on me croit. J’ai parfois souvent eu la sensation que certaines personnes pensaient que je mentais ou que j’exagérais. Je pense que cela vient du fait que c’est une maladie aussi peu connue, ce qui peut provoquer de la méfiance par rapport aux explications que je donne. Je fais en sorte de simplifier, mais pas trop non plus pour ne pas réduire cette maladie à un simple mal de dos ! »
La carte d’invalidité ou de coupe-file lui a été refusée il y a cinq ans. Une situation que comprend Astrid mais qui lui rend le simple fait de prendre les transports difficile. « Selon la Maison Départementale des Personnes Handicapées – MDPH, je ne suis ‘pas assez handicapée’ pour en bénéficier. Ce qui n’est pas tout à fait faux : je n’ai pas de canne, je ne suis pas en fauteuil roulant… Mais parfois, lorsque je suis en crise inflammatoire dans les transports en commun, j’aimerais pouvoir m’asseoir et au besoin brandir ma carte pour faire cesser les regards offusqués de vieilles dames qui veulent ma place lorsque j’arrive à en avoir une. Souvent, je me lève et propose ma place, puis je serre les dents jusqu’à ma station de sortie. »
Pour Julia, il a toujours été hors de question d’évoquer d’emblée son handicap à de futurs employeurs. « Je n’ai jamais parlé de mon diabète lors de mes entretiens d’embauche ou pendant les premiers mois de mes contrats. Je sais que les problèmes de santé peuvent rendre les employeurs frileux. J’avais déjà entendu trop d’histoires allant dans ce sens. Ils se disent que l’on risque d’être plus souvent absents ou moins performants. Je ne voulais pas prendre le risque de passer à côté d’un travail à cause de cela. »
À l’inverse de Sophie et Astrid, Julia n’a jamais fait de demande de Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé, estimant ne pas en avoir réellement besoin pour le moment. « Je redoute surtout les démarches, qui peuvent être longues et compliquées. » Néanmoins, elle a demandé à ce qu’un frigo soit installé au sein de l’open space où se trouve son bureau, afin qu’elle puisse y stocker une piqûre d’urgence à lui faire en cas de malaise hypoglycémique très sévère. « C’est vital pour moi mais pour l’instant, je l’attends toujours, regrette-t-elle. »
Libérer la parole et accepter son handicap
Le fait de souffrir d’un handicap invisible pose un double enjeu : à la fois dans la reconnaissance en tant que malade par autrui mais également par soi-même. Nombreux sont les malades qui ne se sentent pas réellement légitimes ou concernés lorsque l’on évoque le mot « handicap ».
« Je ne me sens pas vraiment handicapée, nous dit par exemple Sophie. C’est difficile à expliquer mais je n’ai pas envie d’être dans une ‘case’. J’ai toujours eu une vie ‘normale’, des amis, une famille, une vie professionnelle… J’ai du mal à me considérer comme handicapée, même si c’est le cas », reconnaît-elle.
Évoquer son handicap peut s’avérer être libérateur. Quand Julia souffre des effets secondaires de la maladie, elle n’hésite plus à en parler. « Les gens sont alors plus compréhensifs et n’associent pas mon attitude à quelque chose de négatif. Ils ne risquent pas de penser : ‘C’est quoi son problème à celle-ci aujourd’hui ? Elle a dû se lever du pied gauche !' ».
Je préfère que les gens voient la personne que je suis avant mon handicap.
Officialiser avec ses pairs, porteurs d’atteintes similaires, peut également apporter une certaine protection contre les jugements négatifs et stigmatisants. « Pouvoir s’abriter derrière la chaleur du groupe, plutôt que d’être isolé dans sa propre intériorité, permet de se sortir de l’épineux dilemme de la dissimulation ou non de son handicap », écrivait Alain Blanc, sociologue et professeur à l’Université Pierre-Mendès-France de Grenoble, dans le numéro de Faire Face de juillet-août 2020.
Julia évoque quelquefois sa maladie sur les réseaux sociaux : « Je peux faire une story ou un post sur le sujet, mais je ne me vois pas en faire un compte dédié, comme le font certains malades. Par contre, je trouve leur démarche super et je suis de près quelques diab-influenceurs. Ils donnent des conseils avisés, permettent aux malades de rester informés sur les nouveaux traitements et de se sentir moins seuls. »
Astrid a parlé de sa maladie avec ses proches dès que le diagnostic a été posé. « J’ai dans un premier temps fait face à leur incompréhension ou leurs mots dubitatifs du type ‘Oui mais ça va ? Tu ne vas pas en mourir’, m’a par exemple dit mon père lorsque je lui ai expliqué de quoi je souffrais. À force d’explications et voyant mon état s’aggraver (ou ne pas s’améliorer) ils ont fini par comprendre. » Néanmoins, la jeune femme doit très souvent leur faire des piqûres de rappel, « car comme cela ne se voit pas, ils semblent parfois oublier que je suis malade et que ça ne changera pas. Il faut dire aussi que j’ai une soeur aînée handicapée lourdement depuis sa naissance, donc à côté, moi, je ne m’en sors pas trop mal… », nous explique-t-elle.
Avec ses amis, elle a tendance à éviter le sujet. « C’est difficile d’expliquer pourquoi je ne vais pas les voir, ou pourquoi je ne me rends pas disponible pour les recevoir car je suis simplement fatiguée. » De même, elle n’évoque la maladie avec ses collègues que lorsque cela devient vraiment nécessaire, « pour ne pas qu’ils pensent que je me drogue quand j’arrive le matin très fatiguée, notamment lorsque j’ai pris des anti-douleurs. »
Autant de regards et de questions qu’Astrid préfère, sauf nécessité, s’épargner : « J’apprécie le fait de ne pas ressentir de regards de pitié ou de regards insistants et curieux de la part de personnes qui ne me connaissent pas. J’ai déjà ressenti ce regard sur le handicap de ma grande sœur et c’est assez déroutant. Je préfère que les gens voient la personne que je suis avant mon handicap, même s’il est évident qu’il fait partie de moi et qu’il forge la personne que je suis aujourd’hui ».
De l’aide du côté des associations
Face à la double peine de la gestion quotidienne de la maladie et se sa reconnaissance comme telle par autrui, les personnes en situation de handicap peuvent compter sur des associations. Soutien de proximité, information, groupes de parole, formation… Nombreuses sont celles à multiplier les initiatives et dispositifs pour accompagner les malades au quotidien, à défaut d’une prise en charge optimale de leurs besoins et contraintes par une société qui, aujourd’hui encore, accuse un retard sur ces questions.
C’est notamment le cas d’APF France Handicap, qui revendique la pleine reconnaissance de tous les handicaps invisibles. « L’association s’investit également auprès des Centres d’action médico-sociale précoce (CAMPS), chargés du dépistage et du diagnostic des déficits et des troubles, mais également de la prévention ou de la réduction de l’aggravation des handicaps, qu’ils soient visibles ou non, chez les enfants de 0 à 6 ans », détaille Patrice Tripoteau.
En mars 2021, l’association se portera partie civile dans un procès pour discrimination contre le Lycée Molière, dans le 16ème arrondissement de Paris. En 2016, son proviseur, Myriam Honnorat, avait en effet refusé de continuer à accueillir dans son établissement Amélie Marc, atteinte de la maladie de Lyme.
La jeune fille, alors âgée de 19 ans, y suivait des études de lettres classiques dans le cadre de sa deuxième année de classe préparatoire. Bien qu’elle éprouvait des difficultés à se déplacer et donc à rejoindre sa salle de cours au deuxième étage, le lycée disposait de pièces libres au rez-de-chaussée, où les cours auraient pu être dispensés. « AFP France Handicap souhaite ainsi rappeler à l’ensemble des responsables d’établissements scolaires leurs obligations en matière de scolarisation dans les conditions définies par la loi handicap de février 2005 », nous indique son Directeur adjoint.
Tout le monde a tendance à penser que ce qui ne se voit pas n’existe pas. C’est donc pour faire « exploser les préjugés » que l’Alliance maladies rares a produit un film dans lequel le jeune Max porte ses vêtements à l’envers, suscitant un regard désapprobateur des autres parents d’élèves. En fait, Max protège sa peau rendue extrêmement fragile par une épidermolyse bulleuse, maladie qui provoque des plaies au moindre frottement.
Dans le même esprit, l’Union nationale des syndromes d’Ehlers Danlos (UNSED) a récemment diffusé un petit clip sur le thème « Je roule beaucoup mais je marche encore ». Son but ? Montrer l’intérêt d’un fauteuil électrique en cas d’entorses et de luxations à répétition. « On nous juge sans rien connaître de notre maladie », déplore Valérie Gisclard, présidente de l’UNSED, dans le magazine Faire Face.
Comme l’écrivait Antoine de Saint-Exupéry, « on ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »
* Les prénoms ont été modifiés.
Source MARIE CLAIRE.