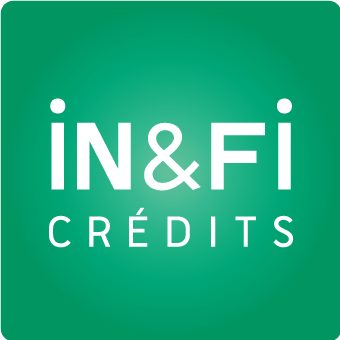En matière d’aide et de soin, les frontières entre contrainte et consentement sont plus floues qu’il n’y paraît.
Monsieur Duclos vient de donner son accord pour entrer dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, autrement dit un Ehpad. Il a enfin signé son contrat de séjour. Obtenir son adhésion n’a pas été une mince affaire. À la fin de son hospitalisation dans un service de psychiatrie, il voulait en effet rentrer chez lui, mais entre-temps son appartement a été vendu avec l’aide de ses enfants. Il a fini par accepter la solution qui lui était proposée, les personnels soignants ayant usé de quelques artifices.
Ils l’ont accompagné chez lui, comme il le souhaitait, mais en évitant de préciser que son chez-lui était désormais l’Ehpad. Pour faciliter les choses, ils ont soutenu ce pieux mensonge par une petite mise en scène. Avec l’aide des proches et du personnel de l’Ehpad, ils ont pris soin de placer dans sa future chambre quelques-uns de ses meubles et de tapisser les murs de photos de sa femme et de ses enfants. Monsieur Duclos s’est tout de suite senti chez lui.
Rassuré, il a signé sans protester le précieux contrat de séjour. Il semble même retrouver ses habitudes. À table, il aime accompagner son repas de quelques verres de vin. Certes, il aurait préféré avoir sa propre bouteille. Mais non, cela ne se passe pas ainsi dans l’Ehpad. Le directeur explique:
«Monsieur Duclos est un peu porté sur l’alcool. Il faut faire attention. Dans ce genre de cas, on utilise de petits verres. Comme cela, on lui sert du vin quand il demande… mais en faibles quantités. On répond à ses attentes, mais pas trop, et tout le monde est content.»
Cet exemple fictif illustre bien les difficultés de mise en application des principes de la démocratie sanitaire, en particulier en ce qui concerne la notion de consentement, dont les frontières sont parfois pour le moins incertaines.
L’adhésion doit rester libre
Depuis maintenant deux décennies, les politiques sanitaires et sociales cherchent à rendre plus démocratiques les prises en charge des patient·es ou des résident·es. Au centre de cette procédure: le consentement éclairé.
Sauf exception –en psychiatrie notamment–, aller à l’encontre de l’avis des personnes, les contraindre à se soigner ou à entrer dans tel ou tel établissement n’est pas autorisé, du moins en principe. L’individu doit consentir. Plus encore, il doit être informé, être tenu au courant des risques liés à l’intervention qui le concerne, et plus largement des conséquences de ses choix. Bref, il doit être éclairé et son consentement ne saurait être forcé. Son adhésion doit rester libre.
De ce point de vue, la procédure qui permet de faire entrer Monsieur Duclos dans un établissement ou de l’empêcher de boire trop de vin ne semble pas rentrer dans les cases de la démocratie sanitaire. Certes, il a bien signé un contrat de séjour. Mais il est clair que son consentement n’a pas été entièrement libre ni entièrement éclairé. Privé de son domicile, il n’avait plus d’autre choix que l’Ehpad. Les subterfuges imaginés par les aides-soignant·es avec l’aide des enfants, pour conjurer un éventuel refus et pour éviter le recours à la force, peuvent difficilement être considérés comme des informations visant à aider Monsieur Duclos à faire ses propres choix. La signature atteste de l’existence d’un consentement formel; mais celui-ci paraît plus embrumé qu’éclairé.
Peut-être n’y avait-il pas d’autres moyens pour obtenir l’acceptation de Monsieur Duclos. Et puis, pour les proches comme pour les professionnel·les qui avaient à cœur de trouver le meilleur cadre de vie possible pour Monsieur Duclos, cette solution constitue un compromis acceptable. Il n’en demeure pas moins que cette méthode qui s’appuie sur la ruse ne saurait servir de modèle.
La patientèle partenaire du personnel
Le modèle, il faut le chercher ailleurs. Notamment dans les formulaires d’information et de consentement qui sont proposés au patient ou à la patiente dès lors que celle-ci fait l’objet d’une intervention. Ces documents clarifient les choses. Ils constituent la preuve que la personne a bien été informée par le médecin, puisqu’ils expliquent les tenants et les aboutissants de l’intervention et listent tous les risques encourus, que ceux-ci soient mineurs ou majeurs, qu’ils soient rares ou fréquents. Ils indiquent ce qu’il convient de faire pour les réduire.
Ainsi éclairé·es, les patient·es, devenu·es partenaires des professionnel·les qui les soignent ou les prennent en charge, peuvent décider en toute connaissance de cause. Une telle démarche tend à être largement diffusée. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux notices que l’on retrouve dans le moindre médicament ou bien encore aux contrats de séjour qui indiquent les droits et les devoirs de la résidente ou du malade quand celui-ci est hospitalisé ou, comme Monsieur Duclos, hébergé.
Un tel modèle produit certainement des effets positifs. Il fixe un idéal grâce auquel peut être mesuré l’écart entre la théorie et la pratique. Il est clair en effet –chacun·e peut en faire l’expérience– qu’on n’est jamais sûr qu’un consentement soit librement consenti.
Un modèle intéressant, mais à la portée limitée
L’information communiquée à la personne sur tous les risques auxquels celle-ci s’expose en prenant un traitement ou en acceptant une intervention suffit-elle à en faire un·e patient·e éclairé·e? La personne a beau être avertie, elle se lancera rarement dans une étude bénéfices/risques approfondie avant de prendre sa décision. Il y a fort à parier que, devant la masse des informations transmises, elle s’en remettra plutôt à l’avis ou à la prescription des praticien·nes, à la confiance qu’elle leur accorde ou non, à l’avis de proches, etc.
Le modèle n’est pourtant pas inutile. Il est même performatif au sens où il indique au patient ou à la patiente que celle-ci a désormais son mot à dire, et où il invite le ou la professionnel·le à faire preuve de vigilance concernant les droits et libertés des usager·es. Dans le cas de Monsieur Duclos, l’existence de ce modèle aide à s’interroger sur la qualité de sa prise en charge; il force le questionnement éthique.
Mais ce modèle a son revers. Il focalise en effet l’attention sur un moment particulier de la prise en charge et du soin, celui de l’acte proposé par un·e professionnel·le et que le patient ou la patiente accepte ou refuse. L’intervention chirurgicale en est la figure paradigmatique, mais on peut également évoquer la prise d’un traitement ou l’entrée dans un établissement par exemple.
De tels actes, ainsi détachés de leurs contextes, s’accommodent bien d’une approche en matière de choix rationnel selon laquelle l’individu, libre et dûment informé par un tiers, choisit entre deux options. Mais le soin ne se réduit pas à une succession de moments, détachables les uns des autres ni à une relation de face à face.
Un insaisissable consentement?
Le soin est un processus dans lequel sont enrôlées de multiples parties prenantes –soignant·es, soigné·es, proches, administrations, institutions, objets techniques, médicaments…– et où s’enchevêtrent des myriades de gestes et d’actes, les uns très techniques, les autres très banals, tous plus ou moins interdépendants.
Ces différentes activités ne peuvent être toutes anticipées, ni attribuées à chacun des acteurs et encore moins figurer dans des formulaires de consentement. Dans ces conditions, la décision est difficilement localisable dans l’espace et dans le temps. Elle se déploie dans toute la chaîne des intervenant·es sans pouvoir être véritablement attribuée avec certitude à l’un·e d’entre elles ou eux.
Or, dès lors que le soin est envisagé non plus comme un acte isolé et situé dans le temps, mais comme une activité faite de processus et de relations, le consentement change de nature. Il n’est plus donné –par le ou la patient·e– ni reçu –par le ou la professionnel·le– pour un acte déterminé, mais produit par de multiples interactions entre parties prenantes. Le consentement comme la décision résultent en quelque sorte d’un travail d’influence fortement distribué et dont la visibilité est particulièrement faible.
Ainsi, pour que Monsieur Duclos puisse se sentir chez lui, il aura fallu qu’une grande diversité d’acteurs s’emploient au travers de diverses micro-actions, plus ou moins coordonnées, à rendre in fine l’acceptation pratiquement inévitable. Il aura fallu que des proches se chargent de sélectionner des photos puis de les afficher, que le directeur de l’Ehpad accepte la personnalisation de la chambre, que le déménageur arrive en temps utile, que les aides-soignant·es aient déjà préparé le terrain quotidiennement, etc.
Cette approche du soin comme processus ouvre des questions éthiques qui sont loin d’être résolues. Comment en effet penser la démocratie sanitaire, comment s’assurer de la validité et de la légitimité du consentement individuel quand celui-ci devient insaisissable parce qu’enchâssé dans un processus de décision collective ?
Monsieur Duclos a finalement accepté sa nouvelle demeure. Sait-il que ce faisant il accepte de se soumettre aussi aux horaires des repas, à l’heure du coucher et à diverses autres règles? Probablement pas. Il les découvrira au fil du temps et finira peut-être par les accepter, faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Quoi qu’il en soit, il ne peut revenir en arrière, c’est-à-dire retourner chez lui. En ce sens, son consentement actuel peut être considéré comme un peu forcé. Non point seulement par les règles de l’institution, mais aussi paradoxalement par lui-même, en raison des divers consentements qu’il a pu donner consciemment ou non, sans en mesurer toujours les conséquences, tout au long de la trajectoire de sa prise en charge.
Ce texte prolonge l’intervention menée par Livia Velpry dans le cadre du cycle national de formation 2018-2019 de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST).
Pour en savoir plus: Livia Velpry, Pierre A. Vidal-Naquet et Benoît Eyraud (dir.) (2018), Contrainte et consentement en santé mentale – Forcer, influencer, coopérer, Presses universitaires de Rennes.
Source SLATE.



![« À travers les gestes de tous les jours, les soins, la toilette, les repas, le ménage, etc., ils savent donner toute cette tendresse, dire les mots apaisants, réconfortants [...]. » « À travers les gestes de tous les jours, les soins, la toilette, les repas, le ménage, etc., ils savent donner toute cette tendresse, dire les mots apaisants, réconfortants [...]. »](https://media.ouest-france.fr/v1/pictures/MjAyMTAxMThjZTI1YjE0MGNjZGVlMDA2MmM0MWZhZTVhNjdmY2I?width=940&focuspoint=50%2C25&cropresize=1&client_id=bpeditorial&sign=abfc1f6f029dd879eea5f9db7052fb4a7c0b55a209f3f53cd35ca2b7981ff609)