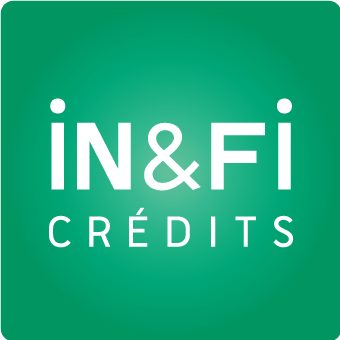Le chef des maladies infectieuses de l’hôpital Raymond-Poincaré est devenu la nouvelle bête noire du monde médical après la publication d’un livre aux positions hétérodoxes sur la crise du Covid-19.

- Dans « Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ? », sorti récemment, le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Garches donne sa vision très personnelle de la gestion de la crise sanitaire.
- Parmi ses attaques répétées, il affirme que l’hydroxychloroquine, traitement promu par Didier Raoult, aurait permis d’éviter 25.000 morts si elle avait été prescrite largement en France.
- Avant cette polémique, Christian Perronne était déjà controversé dans le milieu médical pour ses avis sur la maladie de Lyme.
Son livre critico-complotiste sorti début juin sur la crise sanitaire s’arrache comme du bon pain (Y a-t-il une erreur qu’ILS n’ont pas commise, chez Albin Michel). Numéro 1 sur Amazon devant les recettes gourmandes-croquantes de Cyril Lignac. Ses interventions médiatiques, d’abord limitées aux micros engagés d’André Bercoff sur Sud Radio ou de Jean-Marc Morandini sur Cnews, défouraillent à tout va y compris sur les chaînes grand public. L’homme accuse sans frémir ses collègues médecins d’avoir tué 25.000 Français en refusant de leur prescrire le fameux combo si décrié hydroxychloroquine + azithromycine.
Une activité frénétique finalement récompensée par une saisine du collège de déontologie de l’APHP, son employeur, et du Conseil de l’Ordre national des médecins (Cnom) en fin de semaine dernière. Confidence en interne : « Ça aurait été incompréhensible que l’on ne fasse rien au vu de la proportion qu’est en train de prendre l’affaire. Les médecins sont tenus à la confraternité, et là, on entend des propos violents qui sont en plus réitérés. »
https://youtu.be/j_oR4gXc4WA
Une alliance contre-nature avec Raoult
C’est donc une sacrée performance réussie par Christan Perronne, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Garches. Le Professeur au CV ronflant – ex-conseiller au ministère de la Santé, ancien président de ce qui est devenu le Haut conseil de la santé publique –, passé sous les radars jusqu’ici, tutoie désormais la popularité de l’idole marseillaise Didier Raoult. Le destin des deux hommes est d’ailleurs inséparable sur le débat chloroquine contre le reste du monde. Une alliance paradoxale puisqu’elle ne repose pas franchement sur une vieille camaraderie de médecine née à décorer les murs du réfectoire de phallus en érection.
Ainsi, on résiste mal à la tentation d’exhumer cette tribune du Point de 2015 dans laquelle Didier Raoult découpe son condisciple. « Notre spécificité est que nous avons au Conseil national des universités et au Haut Comité de santé publique, un confrère qui a pris une position de leader du Lyme, sans bagage scientifique spécifique dans ce domaine, autre que ses croyances et le support de ses disciples. Il n’a pas de production scientifique lisible. Il a embrasé les théories alternatives et a même convaincu un grand hebdomadaire qu’il existait un complot tendant à dissimuler (pour quelle raison ?) l’ampleur du désastre. »
Une étude clinique discutée puis finalement retirée
Cinq ans après, Didier Raoult et Christian Perronne nous rejouent pourtant à leur manière le running gag des Guignols sur le couple Balkany. « L’hydroxychloroquine ? Bien sûr que ça marche, j’ai un témoin qui peut le prouver. » Quand Raoult est le dernier à croire à son remède, Il trouve un précieux soutien chez Perronne, qui dépose une étude en préprint sur l’efficacité du traitement promu par le directeur de l’IHU Méditerranée. Et tant pis si elle est aussi discutable sur le fond à cause de ses multiples biais, comme le démontre entre autres cet excellent article de nos confrères de Futura-Sciences.
« C’est une étude qui n’a ni queue ni tête avec des patients qui se baladent d’un groupe à l’autre », tempête Nathan Peiffer-Smadja, coordinateur du réseau des jeunes infectiologues de France, qui a initié la pétition demandant au Conseil de l’Ordre d’agir contre le Professeur Perronne. « On a neuf patients traités par hydroxychloroquine et azithromycine qui sont déplacés dans le groupe de contrôle parce qu’ils n’ont pas reçu le traitement pendant le temps imparti (48h) alors qu’ils finissent en soins intensifs ! Cela fausse toutes les données. D’ailleurs le préprint a été retiré de Medrxiv alors que ça n’arrive jamais. »
Réponse furibarde de Perronne dans L’Obs : « On a été obligé de la retirer parce qu’on s’est pris des seaux de purin sur la tête mais l’article est toujours en comité de relecture dans un journal international. Mes équipes ont reçu des appels de menace de collègues leur demandant s’ils avaient bien réfléchi à leur carrière en signant un papier pareil. » Selon nos informations, certains ont tellement réfléchi qu’ils ont demandé à voir leurs noms retirés de la liste des participants à l’étude avant même sa publication, car ils avaient émis des doutes sur sa méthodologie dès le départ.
Un autre signataire de l’étude, Djillali Annane, chef du service de réanimation à l’hôpital Raymond-Poincaré, le même que Perronne, confirme à demi-mot certaines réticences : « Je n’ai pas demandé que mon nom soit retiré mais à ce qu’avant la soumission pour publication dans une revue à comité de lecture, le plan d’analyse statistique soit revu avec un expert statisticien. » Une précaution qui ne changera rien à l’affaire, selon Pierre Tattevin, président de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française, qui regroupe une large majorité des infectiologues exerçant dans l’Hexagone.
« La chloroquine, on avait envie d’y croire, mais ça ne tient pas la route. Toutes les grandes études internationales menées dans les règles de l’art le montrent, L’OMS le dit, toutes les instances le disent. Comment un grand Professeur comme ça, en fin de carrière, peut camper sur des positions qui ne sont pas tenables ? Allez dire aux gens qui ont perdu des proches que ces derniers auraient pu être soignés, ça a un impact terrible. Je ne m’explique pas ce qui lui a pris. Même en imaginant que la chloroquine était le traitement miracle, ce qu’il n’est pas, on n’aurait jamais guéri 80 % des gens. Au-delà même de la conviction délirante, c’est un mensonge raconté aux victimes du Covid-19. »
La photo qui passe mal
Ceux qui ont renoncé à comprendre n’hésitent pas à parler de mégalomanie, ce qui est une manière d’interpréter une photo parue sur les réseaux sociaux dont on a pu vérifier la véracité. On y voit le Professeur Perronne en arrière-plan, et devant lui une dizaine de jeunes femmes de dos avec des messages de soutien sur leur blouse. « Un grand merci Mr Perronne, un grand homme Mr Perronne, un grand bravo Mr Perronne », et ainsi de suite. La mise en scène a suscité un certain malaise en interne. « Il s’agit pour la majorité d’infirmières de son service dont on devine tout à fait le lien de dépendance vis-à-vis de Perronne, persifle un confrère. Je ne crois pas qu’elles aient eu beaucoup le choix. » Gardons-nous ici d’employer les grands mots : même ses détracteurs reconnaissent que le Professeur Perronne n’a pas mauvais fond. « Il peut y avoir des pressions, mais il ne va fusiller personne. A côté de Raoult, Perronne, c’est un gentil. Il est respectueux et il laisse les gens tranquilles. »
Si les deux pointures n’ont pas le même caractère, elles partagent la même attirance pour les théories complotistes. Dans son ouvrage, qui relaie par ailleurs un bon nombre de critiques largement admises, comme la mauvaise gestion gouvernementale du manque de masques ou la désorganisation des autorités sanitaires, Christian Perronne reprend à son compte les attaques de Didier Raoult sur la probité de ses confères, qu’il juge achetés par les grands laboratoires. « Au sommet de l’État, les relations personnelles, les services rendus ou les travaux bien rémunérés par l’industrie pharmaceutique se transforment parfois en conflits d’intérêts plus visibles que d’habitude. Un organisme officiel, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), a été le petit théâtre de certains d’entre eux. Un membre éminent de la commission Maladies transmissibles de ce Haut Conseil a ainsi touché 90.741 euros de l’industrie pharmaceutique, dont 16.563 euros de Gilead. Or c’est ce Haut Conseil qui a rendu le fameux avis interdisant l’hydroxychloroquine, sauf aux mourants. »
« Ils ont laissé crever mon beau-frère »
Sur le plateau de Cnews, il va même plus loin, en accusant le CHU de Nantes, en bisbille judiciaire avec Raoult pour cette même histoire de conflit d’intérêts, d’avoir « laissé crever son beau-frère » en refusant de lui administrer le traitement magique. Contacté, le CHU de Nantes, préfère « ne pas rentrer dans cette polémique infondée. L’ensemble des patients pris en charge pour Covid-19 au sein de l’établissement a été traité de manière collégiale, en prescrivant les traitements validés scientifiquement et adaptés à chaque situation individuelle ».
S’il est encore loin de la ferveur autour de Raoult, qui a explosé les records d’audience de BFM l’autre jour lors du remix de Rumble in the Jungle contre Bourdin, les prises de position du Professeur Perronne commencent à lui valoir un certain succès sur les réseaux sociaux. Au point de condamner ses opposants à des raids bien sentis sur Facebook et ailleurs de la part des admirateurs de la doublette infernale. « Recevoir un message avec mon adresse et un avertissement du genre « justice sera faite », ça ne fait jamais plaisir », avance Nathan Peiffer-Sadja.
Il accuse ses confrères de collusion avec les laboratoires
La tension serait même montée d’un cran depuis que l’utilisation du Remdevisir, le produit phare de Gilead, a été validée par l’Agence européenne du médicament le 15 juin, malgré une incidence minime sur la mortalité. « Oui, il y a un problème de financement de la médecine », reconnaît sans fard le jeune interne à Bichat. « Aux internes, on dit « déplacez-vous dans des congrès et publiez des travaux de recherche pour faire carrière », mais ni l’État ni les facultés ne veulent payer. Un interne qui gagne 1.800 euros par mois, s’il doit payer 800 euros de sa poche pour aller à un congrès, il fait comment ? Et ben c’est l’industrie qui paye. C’est tellement hypocrite ceux qui disent « il faut arrêter ça tout de suite ». A quel point cela peut influer sur les décisions médicales ? Il y a sûrement débat, mais aucun médecin ne va laisser mourir des gens parce qu’un labo lui a payé un déplacement un jour. »
« Ce que dit Perronne est assez démagogique, mais ça prend bien, renchérit Pierre Tattevin. Ces liens d’intérêt dont il parle, tous les médecins qui exercent pour des unités de recherche en ont. Mais la plupart du temps, c’est pour pouvoir faire des expérimentations. Lui-même en a bénéficié. Alors, si la parade quand on explique que la chloroquine ne fonctionne pas, c’est « vous dites ça parce que vous êtes payé par le labo concurrent », bon… Le Remdevisir, c’est vrai que ce n’est pas très spectaculaire, mais c’est le seul traitement antiviral qui a démontré un peu d’efficacité. Mais il ne faut pas que Perronne ce soit l’arbre qui cache la forêt. Il a toujours été un outsider. »
« Avant lui, les médecins me regardaient de haut »
Le Chef du service d’infectiologie du CHU de Rennes fait ici référence au rôle controversé de Christian Perronne dans la recherche contre la maladie de Lyme. Défenseur de la théorie parfois colportée, mais jamais prouvée, du chercheur nazi réfugié aux Etats-Unis qui aurait trafiqué les tiques pour les rendre plus infectieuses avant leur « évasion » d’une base américaine du Connecticut, le spécialiste accusait déjà en 2015 le milieu médical de cacher au grand public les dégâts causés par cette maladie silencieuse et mal diagnostiquée. Snobé par ses pairs, qui le taxent à l’époque d’obscurantisme et d’alarmisme inutile, le Professeur Perronne tombe alors comme une bénédiction pour des milliers de malades « en errance médicale », à l’image d’Armelle Cyuela.
Désormais présidente de l’association Vaincre Lyme, elle a lancé une (autre) pétition pour défendre Christian Perronne. « Avant lui, les médecins me regardaient de haut, disant que mes tests ne valaient rien et que je n’étais pas malade. J’ai fini par être hospitalisée à Garches. Il m’a aidée à un moment où j’en avais grand besoin. Il y a des milliers de personnes qui souffrent terriblement et lui a consacré sa vie à essayer de faire connaître cette maladie. Alors, sur la chloroquine, s’il dit que ça marche, je suis derrière lui à 100 %. » Plus de 80.000 signataires partagent son avis. Le soutien populaire, toujours. « Les dégâts sont faits dans l’opinion publique, concède Pierre Tattevin. Ce qu’on espère maintenant, c’est que la sanction soit assez intimidante pour que lors des prochaines épidémies, des Raoult ou des Perronne réfléchissent à deux fois avant de dire qu’ils savent mieux que tout le monde. »
Aucune plainte n’a encore été déposée devant la chambre disciplinaire. « On attend que le conseil de l’ordre interdépartemental des Hauts-de-Seine se prononce, comme le veut l’usage », temporise le Cnom. Quant aux équipes de l’hôpital Raymond Poincaré, elles font le dos rond. « On a d’autres chats à fouetter et des patients à prendre en charge. Pour le reste, on met des œillères, même si on est déçus de la tournure que prennent les choses. »
Source 20 MINUTES.