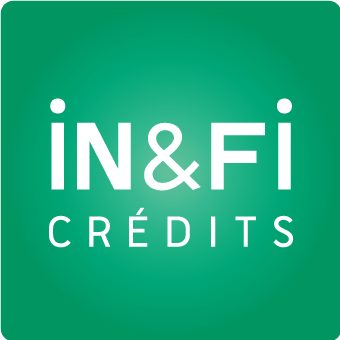« Notre fils n’aura pas école pour la troisième année de suite », « Notre fils est déscolarisé depuis 2018 », « J’ai un enfant handicapé et je ne trouve malheureusement pas de place »… Sur marentree.org, les témoignages de parents d’enfants handicapés s’accumulent, dans la foulée de la campagne #jaipasecole, lancée par l’Unapei, mouvement associatif français qui regroupe 550 associations autour du handicap. En Ile-de-France, la situation n’est pas meilleure qu’ailleurs, avec ses spécificités départementales. 20 Minutes a recueilli le témoignage de trois familles, dont les enfants ont été orientées vers des structures inadaptées, ou qui sont carrément sans solution pour la rentrée.
C’est le cas d’Ewa Grajner, maman de Filip, 7 ans, diagnostiqué autiste à 22 mois, et qui habite à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Il est ce qu’on appelle « non verbal » : il ne parle pas du tout et communique en pointant avec le doigt, avec des pictogrammes. « Il ne saura sans doute jamais lire, ni écrire. Peut-être jamais parler », explique sa mère, et c’est la raison pour laquelle son fils a besoin d’une structure qui le prend en charge avec ergothérapeute, psychologue, psychomotricien, orthophoniste, etc. pour qu’il progresse.
Pendant quatre ans, Filip a été correctement pris en charge à l’hôpital de jour à Neuilly-sur-Marne selon sa mère, à raison de 32 heures par semaine. Mais en juillet dernier, le suivi s’est arrêté, et malgré les efforts des parents depuis un an, impossible de trouver une place en institut médico-éducatif (IME), la seule structure adaptée aux yeux des parents de Filip.
A l’IME de Soubiran, pourtant dans leur département, ils se sont même vus répondre que leur domicile était hors du « secteur géographique » de l’institution, qui n’est pourtant pas censée sectoriser. En juillet, une convention entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le département de Seine-Saint-Denis et la MDPH a été signée pour améliorer les délais de traitement.
« Cela va à l’encontre du droit à l’enfant »
D’autres parents ont dégoté une solution, mais au prix de coûteux sacrifices financiers. C’est ce qui s’est passé pour Marie*, mère d’une petite Mégane* de 7 ans et demi, porteuse d’un syndrome génétique rare, qui nécessite là aussi une prise en charge pluridisciplinaire. Pour scolariser l’enfant, Marie, qui habite Paris, s’est résolue à embaucher une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) privée, la directrice d’école lui ayant clairement dit, selon son témoignage, que l’enfant ne serait pas pris à l’école avec une AESH de l’Education nationale, qui ne reçoit que 60 heures de formation.
« Cela va à l’encontre du droit à l’enfant, c’est comme si on disait « votre enfant ne va pas rentrer dans cette classe-là car on n’a pas l’enseignant adapté ». C’est à l’école de s’adapter, pas à la famille », s’insurge Sonia Ahehehinnou, vice-présidente de l’Unapei.
Entre-temps l’enfant avait commencé à se mutiler
Les prises en charge inadaptées peuvent se révéler catastrophiques et rendre encore plus difficiles la situation des familles d’enfants handicapés, et surtout des enfants eux-mêmes. C’est ce qui est arrivé à Luc*, enfant autiste de 11 ans, qui réside dans le Val-de-Marne. Scolarisé au départ à l’école selon le récit de son père Sami*, l’enfant devait subir des changements incessants de classe, les enseignantes et enseignants de l’établissement ayant refusé de le prendre en charge plus d’une heure d’affilée. A quoi se sont ajoutés plusieurs changements d’institutrices, parties en congé maternité.
« Le pédopsychiatre a alerté le médecin scolaire dès le lendemain de la rentrée que cela allait majorer les troubles de l’enfant », explique Sami, mais ce n’est qu’en décembre, quand député et Défenseur des droits se sont déplacés, que l’enfant a été autorisé à intégrer normalement une classe. Entre-temps l’enfant avait commencé à se mutiler, et il a finalement été décidé de le déscolariser. A la rentrée, la formation à « l’école inclusive » deviendra obligatoire pour tous les nouveaux enseignants.
« On est en train de créer des cas complexes, tout cela parce qu’à la base le système n’est pas adapté aux enfants », se désole Sonia Ahehehinnou. Et Luc, qui suivait depuis les cours par le Cned, est aujourd’hui également privé de cette ressource, selon son père, parce que la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) a notifié une scolarisation en classe Ulis en juillet, alors que les dernières commissions d’attribution se tiennent en juin, rapporte-t-il.
Inégalité territoriale
Les délais d’attente peuvent être très longs, jusqu’à 4 ans, et varient selon les départements, provoquant une inégalité territoriale. « Tous les départements ne s’investissent pas de la même façon pour la prise en charge du handicap et la scolarisation : le Val-d’Oise et les Yvelines ont moins d’implication que la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne », explique Bruno Lefebvre, président de l’Unapei Ile-de-France. Les délais sont les plus longs dans le Val-d’Oise : il faut y compter quatre ans pour une place en institut médico-éducatif, contre « seulement » un an et demi ou deux ans en Seine-et-Marne ou dans l’Essonne.
Pour une place en milieu scolaire ordinaire, c’est dans l’académie de Versailles où cela pêche le plus, à cause d’un manque d’AESH, selon Bruno Lefebvre. « Les enfants sont dits « scolarisés » mais ne le sont en fait que sur une demi-journée par semaine. »
Familles sacrifiées
Les enfants trinquent mais les familles aussi. Ewa Grajner, qui était adjointe de direction dans une grande surface, a dû arrêter de travailler, tout comme Marie. « Je ne pouvais pas organiser l’agenda de ma fille jusqu’à 2 heures du matin tous les jours », dit-elle. Les vacances suivent pour cette dernière le rythme des thérapies de sa fille : « Quinze jours en Espagne l’an dernier pour des soins intensifs dans une clinique, cette année en Bretagne pour une rééducation neuro-fonctionnelle dans un centre spécialisé qui fait beaucoup de pédiatrie et de neurologie. » Sans compter les efforts financiers : les « vacances » de Mégane coûtent entre 2.000 et 3.000 euros, et ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Au quotidien, comme Marie a choisi d’être aidée financièrement pour une prise en charge humaine, les soins qu’elle peut requérir pour sa fille ne lui sont pas remboursés. Il fallait choisir, c’était l’un ou l’autre. « On ne peut pas cumuler les deux », explique-t-elle.
Les familles qui font face à ces problèmes sont souvent surmenées, épuisées. Sami, le père de Luc, a lui aussi mis entre parenthèses son métier d’enseignant pour faire l’école à son fils à domicile, mais il a été rattrapé par des ulcères à l’estomac, qu’il attribue au stress généré par la situation de son enfant. Double peine, il a ensuite été déclaré inapte à toute fonction publique à vie à la suite du passage d’un expert, selon son témoignage, une décision contre laquelle il se bat aujourd’hui au tribunal. « N’importe quelle maman dira qu’elle est prête à se suicider quand elle doit refaire un dossier à la MDPH », abonde Marie.
Que fait le gouvernement ?
En face, le ministre de l’Education met en avant l’augmentation du nombre d’accompagnants d’enfants en situation de handicap (AESH), passés de 70.000 à plus de 120.000 aujourd’hui. Mais ces chiffres sont largement contestés par les parents que nous avons interrogés, qui affirment ne voir aucun progrès sur le terrain. « Sur le papier c’est magnifique, mais on ne fait rien », se désole Ewa Grajner. « L’inclusion telle qu’on veut nous la montrer aujourd’hui est à l’opposé de celle qu’on veut nous montrer sur le terrain », renchérit Sami.
Pour Sonia Ahehehinnou, « l’école ne sera réellement inclusive que lorsqu’on aura une évaluation bien concrète des besoins du terrain ». Le gouvernement affirme que 12.000 enfants handicapés rencontrent chaque année des difficultés de prise en charge à l’école (sur 385.000 enfants en situation de handicap scolarisés en classe ordinaire à la rentrée 2020) mais l’Unapei considère que les chiffres sont largement sous-évalués, car ils englobent toutes les prises en charge y compris celles jugées déficientes ou insuffisantes par les parents. Contacté par 20 Minutes, le cabinet de la ministre Sophie Cluzel nous confirme que ce sont bien les heures prescrites par la MDPH qui sont comptabilisées, et non les heures effectives.
* Le prénom a été changé
Source 20 MINUTES.