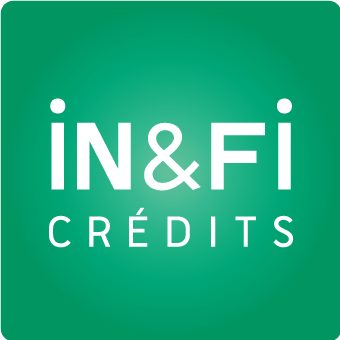A l’occasion de la Journée contre l’obésité, ce mercredi, zoom sur cette maladie qui touche 8 millions de Français, et dont on commence à vraiment parler.

- A l’occasion de la Journée contre l’obésité, ce mercredi 4 mars, la France organise des rencontres pour sensibiliser aux préjugés et aux freins dans la prise en charge de cette maladie.
- Si certaines patientes et associations mettent en lumière la grossophobie et les difficultés pour être soignées, la médecine a encore quelques progrès à faire.
- Avec le plan obésité, le ministère veut mieux informer le grand public, mieux former les soignants et mieux encadrer la chirurgie bariatrique.
Huit millions de malades en France et une prise en charge déficiente. Il ne s’agit pas du coronavirus, mais de l’obésité. Un problème de santé publique qui va croissant : en 1997, 8 % des Français adultes avaient un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30. En 2016, ils étaient 17 %.
A l’occasion de la Journée mondiale contre l’obésité ce mercredi, zoom sur cette maladie dont la prise en charge est loin d’être optimale.
Faire changer le regard
Le thème de la grossophobie et la visibilité de l’obésité se sont imposés dans les médias ces derniers mois, avec des livres comme On ne naît pas grosse, Gros n’est pas un gros mot, le documentaire « Ma vie en gros », la une (censurée) de Télérama… Mais selon un sondage Odoxa*, 67 % des Français estiment (encore) que perdre du poids est d’abord une question de volonté. « On représente ce que les gens ne veulent pas être, résume Anne-Sophie Joly, patiente et fondatrice du Collectif National des Associations d’Obèses (CNAO). L’obésité génère 18 pathologies. Ce n’est pas un choix de vie ! »
Voilà pourquoi l’objectif de cette journée est de faire évoluer la vision du public, pour que l’obésité ne soit plus considérée comme une tare, mais une maladie chronique qui exige un suivi particulier. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a d’ailleurs reconnu l’obésité comme une maladie… en 1997. Et nombreux sont les soignants et patients à estimer qu’il y a urgence. « L’obésité coûte 22 millions d’euros chaque l’année à l’État, assure Anne-Sophie Joly. Nous, ça nous coûte notre qualité de vie, notre espérance de vie, l’image qu’on transmet et qu’on a de nous-mêmes. »
Des causes multiples et méconnues
Tant que ces préjugés ne seront pas de l’histoire ancienne, la prise en charge risque d’être freinée. « Le premier problème pour diagnostiquer ces patients, c’est que ces personnes ne se sentent pas malades, mais se disent que c’est leur faute si elles grignotent », assure Agnès Maurin, directrice générale de la Ligue contre l’obésité**. Or, la recherche a récemment fait un bond dans le domaine, en dévoilant que les causes de l’obésité étaient aussi complexes que multiples : prédispositions génétiques, métabolisme, dysfonctionnement hormonal, microbiote, perturbateurs endocriniens, pollution, manque de sommeil, traumatismes…
« On s’est rendu compte, par exemple, que certains patients peuvent libérer davantage d’hormones de la faim, la ghréline , ou pas suffisamment d’hormones de satiété, la leptine », explique Agnès Maurin. Trop souvent, encore, ces patients tombent dans les bras de vendeurs de rêves. Et de régimes en échecs, le poids s’envole et l’estime de soi s’effrite. Autre problème, les outils médicaux ne sont pas assez précis ou adaptés aux grandes tailles. Ainsi, les généralistes ont souvent des balances simples au lieu d’un impédancemètre, qui permet de différencier les kilos dus à la graisse et le poids lié aux os et muscles. Enfin, aujourd’hui, certains soins pour ces obèses chez un diététicien ou un psychologue, par exemple, ne sont pas tous remboursés.
Information, formation et chirurgie bariatrique
Pourtant, il serait faux de dire que rien n’a été fait. « En médecine, pour avoir un début de certitude sur la prise en charge, il faut cinquante ans de recul. En obésité, on ne les a pas, nuance la présidente du CNAO. On est en train d’écrire l’Histoire. La France fait partie des pays les plus actifs. Les réglementations, on les a, maintenant, il faut passer aux actions. » Justement, le 8 octobre 2019, Agnès Buzyn a officialisé la feuille de route du plan Obésité 2019-2022, qui met en avant un accompagnement coordonné entre ville et hôpital, mais également pluridisciplinaire. « Dès 2020, chaque patient devra bénéficier d’une évaluation de son dossier dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, afin que lui soit proposé le traitement le plus pertinent », précise le plan. Depuis janvier, le ministère échange avec les associations pour dévoiler des actions plus concrètes, idéalement avant la fin 2020. Avec trois pistes principales : améliorer l’information des patients, la formation des soignants et mieux encadrer la chirurgie bariatrique.
Pour Anne-Sophie Joly, l’angle manquant en France, c’est surtout la prévention. « Jusqu’à présent, on ne prenait en charge les patients qu’à partir d’un IMC supérieur à 35. Là, on veut aiguiller tout le monde dès l’apparition d’un surpoids. » Deuxième priorité, la formation des médecins. Le ministère devrait se pencher sur la formation initiale et continue des médecins comme des paramédicaux. « Dans les études de médecine, l’obésité se résume à 5 heures et au régime hypocalorique », relève Mélanie Delozé, diététicienne et conseillère scientifique de la Ligue contre l’obésité. Une méconnaissance aux conséquences désastreuses : les personnes obèses sont souvent renvoyées à leur poids avant d’être soignées. La Ligue contre l’obésité espère qu’un jour, une spécialité de médecine sera créée pour que des « obésitologues » traitent de façon adéquate et globale cette maladie. Comme pour le cancer.
Enfin, troisième priorité du ministère : évaluer et mieux encadrer l’offre de chirurgie bariatrique. Selon un rapport de l’Igas de 2018, le nombre d’interventions a triplé en dix ans, pour atteindre 60.000 opérations en 2016. Or, ces opérations ne sont pas toujours adéquates et le suivi peu assuré.
Accompagner de façon globale
Ce que les patients réclament, c’est surtout une vision à 360 degrés de la maladie. Depuis 2010, la France compte 37 centres spécialisés obésité (CSO), où l’accompagnement est pluriprofessionnel et les outils médicaux adaptés (IRM, chaises roulantes, brancards…). Insuffisant au vu du nombre de malades ? La Ligue contre l’obésité a prévu d’ouvrir des centres spécialisés pour compléter l’offre. « Ils seraient ouverts à tout type de public, pour faire un recrutement en entonnoir et diagnostiquer un maximum de personnes obèses. On y trouverait des généralistes, des diététiciens, des psychologues, des enseignants en activité physique adaptée, des infirmières, des kinésithérapeutes, des tabacologues et des cours d’éducation thérapeutique », précise Agnès Maurin. Un premier centre devrait ouvrir en septembre 2020 à Montpellier. Deux autres, à Dax et Martigues, sont en préparation.
* Sondage Odoxa réalisé les 5 et 6 février sur Internet sur 1.002 Français selon la méthode des quotas.
** La Ligue contre l’obésité est une association de bénévoles créée en 2014. Elle compte parmi ses fondateurs un chirurgien de l’obésité.
Source 20 MINUTES.