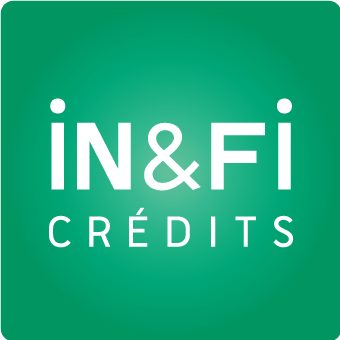C’est un sujet que l’on n’aborde peu. Ou pas.
Comment grandir aux côtés d’un frère ou d’une sœur en situation de handicap ?
Comment trouver sa place dans une fratrie déséquilibrée par la maladie ?
Des sœurs concernées nous livrent le récit de leur enfance particulière.

“Je ne veux plus me taire, je ne veux plus me cacher. Je veux crier, vociférer, moi que tout le monde considère comme une femme douce, calme et discrète”. Voici comment débute le livre-témoignage d’Anne-Laure Chanel, Soeur sans bruit (Ed. du Rouergue), dans lequel elle revient sur son enfance avec deux-petits frères, et notamment Paulin, polyhandicapé depuis une hémorragie cérébrale survenue à la naissance. Avec des émotions débordantes, elle évoque sans faux-semblants ses souvenirs au sein de cette fratrie, « différente ».
S’il n’est pas toujours évident de trouver sa place parmi ses frères et sœurs, comment cela se passe quand l’un.e d’entre eux ou elles demandent une attention particulière ? Comment rester enfant quand on est plongé dans la réalité abrupte de la maladie grave ou du handicap sérieux face à son semblable ? Et quel adulte devient-on ?
Un quotidien bien différent de celui des copains
“Ils sont des centaines de milliers de jeunes en France, des millions en Europe, à souffrir dans l’ombre d’un frère ou d’une soeur frappé d’une maladie grave ou d’un handicap sérieux”, écrit Muriel Scibilia*, en introduction de son dernier ouvrage Sortir de l’ombre, les frères et sœurs d’enfants gravement malades (Ed. Slatkine). Pourquoi ce livre ? Pour donner la parole à celles et ceux qu’elle appelle “les victimes collatérales” de la maladie ou du handicap porté par l’un.e des enfants de la fratrie, et mettre des mots sur leurs souffrances invisibles.
« On ne partait pas en vacances, et on ne faisait rien de particulier les week-ends. On ne pouvait pas, Laura rentrait à la maison. »
Quand Madeline** est née, sa sœur Laura** avait 6 ans. Laura est polyhandicapée depuis sa naissance : elle ne parle pas, ne marche pas et a besoin depuis toujours de soins très particuliers. “J’ai des souvenirs de la toute petite enfance avec elle. A l’époque, on dormait dans la même chambre. Et puis vers l’âge de 10 ans, elle est partie dans un centre spécialisé la semaine, mais elle rentrait tous les week-ends à la maison”, se remémore-t-elle. La jeune femme aujourd’hui trentenaire se souvient surtout de son enfance “pas comme les autres”. “On ne partait pas en vacances, et on ne faisait rien de particulier les week-ends. On ne pouvait pas, Laura rentrait à la maison. Du coup, je n’avais pas grand chose à raconter le lundi en retournant à l’école”, raconte celle qui se souvient, face à l’ennui, s’être très tôt réfugiée dans la lecture.
Des souvenirs qui font écho à ceux d’Anne-Laure Chanel qui se souvient d’étés entiers passés à la maison et du décalage qui se créait avec ses camarades d’école. “Je me souviens qu’une institutrice nous avait demandé de raconter ce que l’on avait fait pendant les vacances et que je m’étais sentie différente”, explique-t-elle. Une différence qui s’est insinuée dans son quotidien d’enfant : pas de cinéma ou de théâtre, pas ou peu de réveillon de Noël… “Tous mes souvenirs ne sont pas très clairs mais je me rappelle que le soir, après les dîners, ma mère rangeait la cuisine et mon père faisait faire des exercices de kinésithérapie à Paulin. Je me suis longtemps demandé ce que les autres familles faisaient de tout ce temps en soirée”, sourit-elle.
Des enfants discrets, « sans problèmes »
Ce quotidien singulier, bouleversé par les soins et impératifs liés à la maladie, a un impact sur la construction émotionnelle des frères et soeurs bien portants. “Généralement, ces personnes ont des grandes difficultés à connaître leurs propres besoins et encore plus à les revendiquer”, explique Muriel Scibilia. Elle raconte que pour la très grande majorité des personnes qu’elle a rencontrées dans le cadre de l’écriture de son ouvrage, elle a pu observer une rupture avec leurs émotions. “Ces jeunes se blindent, apprennent à mettre un masque sur ce qu’ils ressentent, presque par habitude. Ils apprennent très tôt à ne pas faire de vague”, analyse-t-elle.
Une idée que Madeline a intégré au plus jeune âge. “Vers trois ou quatre ans, mes parents m’ont fait consulter une psychologue car je présentais des troubles du comportement : le week-end, quand Laura rentrait du centre où elle passait la semaine, je m’isolais dans ma chambre et je jouais toute seule, sans faire de bruit. J’avais compris que ma soeur avait besoin de plus d’attention de leur part, et je me mettais naturellement en retrait”, se remémore-t-elle. “Je pense que ça m’a beaucoup construite : j’étais en avance par rapport aux enfants de mon âge, plus autonome aussi. Dès le CP, je faisais mes devoirs seule, sans l’aide de mes parents. Lorsque nous invitions des amis et leurs enfants, je préférais me mêler aux conversations des grands plutôt que de jouer. A l’école, à la maison, j’étais une fillette « facile », aidante, « qui ne posait pas de problème » : en bref, une enfant modèle. Je me mettais beaucoup la pression je crois ; il fallait que je réussisse pour deux.”
“Ils et elles acquièrent une maturité rapidement et ne se laissent pas plomber par les petits tracas du quotidien », confirme Muriel Scibilia au sujet de ces petits qui grandissent dans une fratrie concernée par le handicap. Après tout, « ces enfants sont placés de manière précoce face à l’instabilité du monde, ce qui peut d’ailleurs être très fragilisant”, décrypte-t-elle.
Des émotions décuplées souvent refoulées
Elle en profite pour rapeler les enjeux fondamentaux de la vie en fratrie. “C’est la relation la plus longue d’une vie et elle est imposée. On ne choisit évidemment pas ses frères et sœurs. Pour la grande majorité des enfants, c’est une sorte de laboratoire au sein duquel s’expérimentent les sentiments et les émotions, comme la complicité, la tendresse, mais aussi la jalousie et la violence. Quand le handicap ou la maladie grave s’invite dans ce schéma, les sentiments peuvent être exacerbés, mais il n’est pas toujours possible de les exprimer”, explique-t-elle. Avant d’ajouter, “par exemple, c’est normal d’en vouloir à son frère ou à sa sœur, mais peut-on vraiment le dire quand lui ou elle se bat au quotidien contre une maladie grave ?”
« À une époque, j’ai détesté ma soeur. Et je me détestais de la détester. Je lui en voulais de m’empêcher d’avoir une vie normale. »
La réponse est « Non » pour Madeline. « Les rares fois où j’ai osé exprimer mon agacement ou ma colère face à cette soeur qui nous empêchait de vivre « normalement », je me suis sévèrement faite recadrer par mes parents. J’étais « égoïste ». Et pourtant, dans les faits, ma grande sœur prenait beaucoup de place. C’est une parole taboue mais, maintenant que j’ai grandi et que je me suis apaisée à ce sujet, je peux l’admettre : à une époque, j’ai détesté ma soeur. Et je me détestais de la détester. Je lui en voulais de m’empêcher d’avoir une vie normale, de m’avoir fait grandir trop vite. Puis j’ai détesté mes parents. Pourquoi avoir décidé d’imposer cette vie, ce « malheur » à un autre enfant ?”, lâche Madeline.
En rejet total de cette situation, presque dans le déni, Madeline en vient à cacher cette sœur au monde extérieur. « A l’adolescence, en dehors de la maison, je voulais avoir une vie « normale ». Pendant quelques années, j’ai donc totalement tu son existence. Et plus je l’occultais du tableau familial, plus il était difficile de revenir en arrière : j’avais peur que le regard des autres sur moi change. Qu’on me trouve effectivement « égoïste » ou pire, que je fasse pitié”, ajoute-t-elle.
Longtemps, Anne-Laure Chanel a elle aussi refoulé ses émotions, faute de trouver une oreille qui pourrait la comprendre. “Je n’ai jamais vraiment pu parler de mon expérience, jusqu’au jour où j’ai rencontré quelqu’un qui avait un frère handicapé et pour la première fois, je me suis trouvée des points communs. On a parlé et je me suis sentie en phase ! Enfin, je pouvais partager le poids, la honte, le ras-le-bol et la culpabilité de ressentir tout cela. J’aime mon frère, mais parfois c’est difficile à vivre et c’est encore plus compliqué de le dire”, explique-t-elle.
Une charge mentale ad vitam
Si le handicap d’un frère ou d’une sœur n’est pas toujours ressenti comme une souffrance, il affecte invariablement l’équilibre du noyau familial, jusqu’à parfois marquer un tournant traumatique. À 22 ans, Marie-Émilie est l’aînée de Svetlana, 17 ans et Alan, 15 ans. Sa petite sœur est atteinte du Syndrome de Williams et Beuren, une maladie génétique rare. “Je venais tout juste d’avoir six ans lorsque le diagnostic à été posé. Je n’ai que très peu de souvenir de cette période, tout ce que je sais, je le tiens de mes parents, car je suis atteinte d’amnésie traumatique”, raconte la jeune femme. À l’époque, la famille vit à Saint-Pierre-et-Miquelon et doit se rendre au Canada pour que leur petite fille soit prise en charge, et Marie-Émilie est aussi du voyage.
« Je suis atteinte d’amnésie traumatique et de stress post-traumatique, en partie dû à l’opération de ma petite sœur. »
Durant toute son enfance, Marie-Emilie va s’impliquer dans la prise en charge de sa petite sœur. “J’étais consciente que quelque chose n’allait pas, mais j’étais surtout heureuse d’être grande sœur. J’étais très proche d’elle et très à l’écoute, je n’aimais pas qu’elle pleure et voulais toujours la prendre dans mes bras”, raconte-t-elle. Elle se souvient des allers-retours avec le Canada d’abord, des séjours à l’hôpital, de leur retour en France. Si la maladie de sa sœur n’a jamais été un tabou, elle admet que son enfance en a été affectée. “J’ai grandi trop vite et ai pris conscience des dangers de la vie, de la mort par exemple, très tôt. » Et d’analyser avec un certain recul : « Je suis quelqu’un d’assez timide et introvertie. Je ne voulais jamais me faire remarquer ou déranger mes parents avec mes soucis. Je suis également perfectionniste, j’essaye d’être la plus parfaite possible pour ne pas créer de problème”, énumère-t-elle. Des traits de caractères qui rappellent ceux évoqués précédemment par Muriel Scibilia et Madeline.
“Je suis atteinte d’amnésie traumatique et de stress post-traumatique, en partie dûs à l’opération de ma petite sœur. J’ai aussi subi une anorexie pendant 5-6 ans, je ne peux pas dire si cela a un lien avec le handicap de ma petite soeur, peut-être en partie, mais il y a évidemment d’autres facteurs”, confie-t-elle. Heureusement, le tableau n’est pas tout noir et cette différence lui a aussi et surtout apporté de l’ouverture d’esprit, une grande écoute et une relativité à toutes épreuves.
Des qualités qu’entrevoie aussi Madeline, désormais adulte : « J’ai de la facilité à analyser les situations, les émotions des autres, sans forcément qu’ils et elles aient besoin de parler. Je pense que cela est dû au fait qu’il a fallu, très tôt, observer, décrypter le langage non verbal de ma soeur. C’était la condition pour pouvoir échanger avec elle ».
Lorsqu’on lui demande si ses relations avec sa soeur sont aujourd’hui apaisées, Madeline répond par l’affirmative. « Je la vois avec plaisir lorsque je retourne passer quelques jours dans le sud. On s’arrange toujours pour passer un moment en famille, tous ensemble, même si entre temps mes parents ont divorcé. Nous restons unis autour d’elle. La seule chose qui m’angoisse désormais, c’est la possibilité que mon père et ma mère disparaissent avant Laura. Dans ce cas, ce serait à ma petite soeur et à moi de nous occuper d’elle. Bien sûr, nous endosserions la responsabilité, mais quelle charge mentale ! »
Des familles livrées à elles-mêmes
Que l’enfant vive bien ou mal la situation, grandir avec un frère ou une sœur n’est définitivement pas sans incidence pour le reste de la fratrie. Un constat qui n’a évidemment pas vocation à culpabiliser les parents, qui sont eux-mêmes, dans une situation compliquée, souvent démunis face à la situation. “Même si je les ai blâmés durant un temps, je sais que mes parents ont fait du mieux qu’ils pouvaient. Ils n’ont pas reçu d’accompagnement spécifique sur la question. C’était d’ailleurs leur premier enfant. Ils étaient jeunes et totalement largués”, tempère Madeline.
« La société ne reconnaît pas suffisamment la légitimité de ce chagrin, et en minimise l’impact et la profondeur. »
“Il y a certains hôpitaux qui ont des structures d’accueil pour les fratries, des groupes de paroles où les frères et sœurs peuvent s’exprimer. Parfois, ce sont simplement les médecins qui se tournent vers les autres enfants, mais la plupart du temps, ils n’ont pas les moyens de les prendre en charge. Et de toute façon, cela reste insuffisant !”, explique Muriel Scibilia. Elle insiste aussi sur le fait de pouvoir accompagner les parents, qui pour la plupart, ne voient pas que les membres de la fratrie qui ne sont pas directement touchés par le handicap, ne vont pas bien. C’est ce qu’elle nomme les blessures narcissiques. “Mon père m’a dit un jour que ma naissance l’avait sauvé. C’était émouvant et en même temps, très lourd à porter”, se remémore Madeline.
Une situation d’autant plus compliquée quand l’enfant ou l’adolescent en situation de handicap lourd ne peut pas être pris en charge à l’extérieur. En France, il existe différents établissements pour accueillir et accompagner ces jeunes, qui deviennent fatalement des adultes. Mais les places sont rares, les listes d’attente longues. « Laura est entrée en centre à 10 ans, puis à sa majorité, elle a pu entrer dans un établissement pour jeunes adultes handicapés. Mais quand elle a à nouveau atteint l’âge maximum pour continuer à y résider, mes parents se sont heurtés au manque de structures pour personnes en situation de handicap lourd adultes. Comme il était hors de question pour eux de l’envoyer à des centaines de kilomètres, ils ont même, un temps, envisagé son retour à la maison. Ma mère aurait dû arrêter de travailler. Elle a finalement pu être prise en charge près de chez nous, dans une structure adaptée à ses besoins, montée grâce à une association de parents eux-mêmes confrontés à la même problématique dans les années 80. », témoigne Madeline.
Interrogé dans l’ouvrage de Muriel Scibilia, le psychologue Jacques Lecomte parle de résilience et de victimes. La société ne reconnaît pas suffisamment la légitimité du chagrin propre à ces familles, et minimise son impact et sa profondeur. “Ce serait essentiel de reconnaître ce statut de victimes. Ces enfants ont besoin que la société et leurs parents les reconnaissent ainsi, pour qu’eux-mêmes puissent se considérer victimes et enfin assumer cette souffrance, et se projeter enfin sur l’avenir.
* Muriel Scibilia a été professeur de lettres, journaliste et responsable d’un service de communication au sein d’une agence des Nations Unies. Aujourd’hui autrice, elle se consacre désormais à la collecte et la rédaction d’histoires de vie. Son premier ouvrage ‘Côté nuit, côté soleil’ (Ed. Slatkine) donnait la parole à des jeunes malades du cancer. ‘Sortir de l’ombre, les frères et sœurs d’enfants gravement malades’ traite une nouvelle fois de la question des enfants et de la maladie, du point de vue cette fois des frères et soeurs. Les droits d’auteur de cet ouvrage sont intégralement reversés à l’association Enfance et Cancer.
** Le prénom a été modifié
Source MARIE – CLAIRE.