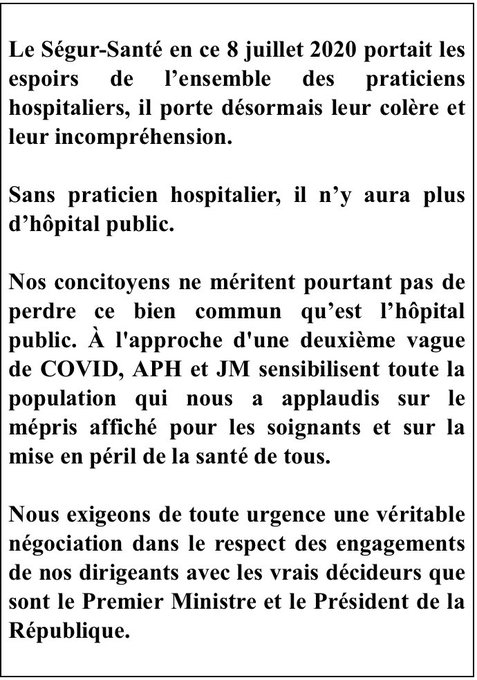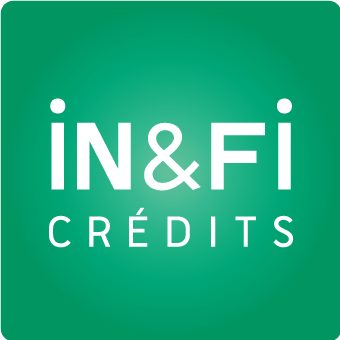Après sept semaines de discussions, le Ségur de la santé prend fin vendredi 09 juillet et les syndicats ont jusqu’à lundi pour se prononcer sur la proposition d’accord qui prévoit une enveloppe de 7,5 millions pour les hôpitaux publics et privés.

Des ouvriers installent les portraits de soignants réalisé par l’artiste JR sur l’Opéra Bastille pour l’opération #ProtegeTonSoignant . — AFP
Cette fois, c’est fini. Enfin, pour le moment. Le Ségur de la santé touche à sa fin ce vendredi 9 juillet. En effet, dans la nuit de mercredi à jeudi, les syndicats et le ministère ont trouvé un accord à 1h du matin, après une négociation marathon de neuf heures. La version définitive de ce protocole a été reçu par les syndicats ce jeudi après-midi. Proposition qu’ils sont censés étudier et faire voter à leur base, s’il y a accord, ce qui n’est pas gagné. Le tout avant lundi soir. Veille de l’intervention d’ Emmanuel Macron, qui devrait ce 14 juillet faire des annonces pour l’hôpital. Si beaucoup se félicitent d’avoir obtenu un montant conséquent pour les paramédicaux, d’autres préviennent que cette avancée risque d’être insuffisante.
Une enveloppe trop limitée
Le projet d’accord propose un montant important : 7,5 milliards d’euros. « Je me félicite de cet effort inédit pour l’hôpital en termes de volume financier », a salué Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France. Une enveloppe qui devrait financer une augmentation salariale de 180 euros mensuels nets pour les professions paramédicales (infirmières, aides-soignantes…), mais également pour les non médicaux (techniciens, brancardiers, etc.) des hôpitaux et des Ehpad publics.
Une avancée, saluée par certains syndicats… mais au goût amer. Depuis des mois, ces derniers exigeaient 300 euros net mensuels supplémentaires. Car les professions sanitaires sont très en deçà de la moyenne de l’OCDE et il s’agit d’un rattrapage d’années sans augmentation, plaident ces soignants. « Bien sûr, ce protocole n’est pas parfait, a reconnu Didier Birig, secrétaire général de FO-Santé auprès de l’AFP. Mais on a été au bout de ce qu’on pouvait faire. Et 7,5 milliards d’euros, ce n’est pas une petite somme : on ne repart pas avec quelques centaines de millions d’euros ».
D’autres ne cachent pas leur déception.
« C’est assez loin de ce qu’on demandait, à savoir un plan d’attractivité fort, tranche Olivier Milleron, cardiologue à Bichat et membre du Collectif inter-hôpitaux (CIH). Deuxième problème : cette revalorisation salariale interviendra en deux temps : d’abord 90 euros en septembre, mais qui ne sera versé qu’en janvier de façon rétroactive (soit 450 euros) et une seconde de 90 euros en mars 2021. Une augmentation progressive, qui repousse un mieux-être tant attendu à 2021… Et agace Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral CGT santé : « Olivier Véran avait promis une revalorisation pour le 1er juillet, puis pour septembre et finalement elle ne sera touchée qu’en janvier. J’espère que la deuxième vague n’aura pas tué tout le monde d’ici là ! »
Les perdants et les gagnants
Dans son communiqué, Force Ouvrière assure que le gouvernement ne voulait faire bénéficier de ce coup de pouce qu’à une partie des équipes soignantes. Mais qu’ils ont obtenu que cette revalorisation touche également les personnels administratifs, ouvriers et techniques. Et le projet écrit a levé un doute : les agents du secteur social ne seront pas concernés. Pour Patrick Bourdillon, il est regrettable d’exclure « une partie de la psychiatrie, de l’aide sociale à l’enfance, les centres de prise en charge des personnes handicapées, soit 35.000 salariés. »
Si une issue semble se dessiner pour le personnel médical et paramédical, les choses semblent en revanche compromises pour les médecins hospitaliers. En effet, aucun projet d’accord n’a été présenté à ce stade, les discussions menées mercredi avec les syndicats de praticiens hospitaliers étant restées bloquées faute d’avancée sur l’enveloppe promise par le gouvernement. La semaine dernière, Olivier Véran avait proposé 600 millions d’euros pour leurs rémunérations, dont 400 millions pour les médecins et 200 pour les internes et étudiants. Les médecins n’ont pas caché leur déception. Et préviennent que beaucoup de praticiens risquent de partir dans le privé…
Justement, ce qui met le plus en rogne certains syndicalistes, c’est que, depuis le début, cette enveloppe intègre le privé. Ils ont estimé que les paramédicaux du privé toucheraient environ 1,6 milliards. Une enveloppe qui pourrait financer une hausse de rémunération de l’ordre de 160 à 170 euros net. Des réunions devront être menées avec les syndicats dans les établissements concernés pour en fixer les modalités. « Le gouvernement a inclus et refuse d’enlever les salariés du privé lucratif, tempête Patrick Bourdillon. L’hôpital public devait être la cible de ce plan, finalement, le privé qui a les moyens de payer ses actionnaires va profiter des cotisations des citoyens. »
Les effectifs
Le Premier ministre Jean Castex est intervenu par surprise dans ces rencontres mardi et a insisté « pour que les questions d’emploi soient également intégrées à la négociation ». C’est chose faite. En effet, l’accord prévoit 15.000 postes supplémentaires. Une avancée saluée par les syndicats, qui regrettent néanmoins que ces effectifs soient financés sur les 7,5 milliards d’euros proposés par Matignon. Ce qui conduit nécessairement à réduire la somme disponible pour les hausses de rémunérations. Mais si on regarde de plus près, il s’agit en réalité de 7.500 créations de postes et de 7.500 des recrutements de personnels sur des postes qui n’étaient jusque-là pas pourvus. Ce qui semble problématique. « Aujourd’hui à l’hôpital Bichat, il y a 100 postes d’infirmières vacants, budgétés mais personne ne veut venir travailler ici, insiste Olivier Milleron. Le problème n’est pas de créer des postes, mais d’attirer les gens… » Deuxième réserve, de la part du cardiologue : « il paraît difficile de se satisfaire d’un chiffre, ce qui compte, c’est le ratio entre soignants et patients en fonction de l’hôpital. Tous n’ont pas tous les mêmes besoins d’infirmières. Aujourd’hui, les ratios sont les mêmes partout. On demande une discussion avec les équipes de chaque hôpital pour mettre en adéquation les moyens et la charge de travail. »
Des zones d’ombre
Les syndicats et collectifs ne cachent pas leur vigilance face à de grandes annonces non détaillées. « Pendant les négociations, on a eu l’occasion de s’affronter pour avoir un fléchage clair : combien pour les effectifs supplémentaires ? Pour le privé lucratif ?, reprend Patrick Bourdillon. Ils refusent de nous répondre. » Et le document définitif n’entre toujours pas dans les détails, au regret de ce dernier.
Autre question : cette enveloppe de 7,5 milliards chaque année s’ajoute à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam), qui est décidé par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), discuté en ce moment et voté à l’automne. « Revaloriser les salaires, c’est essentiel, mais il faut augmenter les finances de l’hôpital public de façon pérenne, assure Olivier Milleron. Donc sortir du tout T2A (tarification à l’activité), qui ne permet pas d’adapter les soins aux besoins, et d’un Ondam raboté chaque année. Si on augmente les salaires sans en augmenter le mode de financement est-ce qu’on risque de nous dire qu’il faut augmenter l’activité pour financer ça ? »
Ne pas oublier les autres sujets
« La revalorisation salariale, c’est l’aspect le plus visible de ce Ségur, mais il ne peut pas se limiter à ça, prévient Patrick Chamboredon, président de l’ Ordre des infirmiers, qui n’a pas participé aux négociations. Les attentes sont plus larges de tous les acteurs. Il y avait quatre piliers, le seul qui devait se solder par un accord, c’est celui-ci, mais les autres doivent encore être travaillés. » En effet, il y a beaucoup à faire sur le front de la gouvernance de l’hôpital, de la simplification de l’organisation, de la collaboration entre soignants… D’ailleurs, une consutation citoyenne organisée du 15 mai au 24 juin sur l’hôpital de demain par le Conseil économique, social et environnemental a fait émerger plusieurs consensus notamment sur la gouvernance et de la gestion administrative des hôpitaux (mieux associer le personnel soignant aux décisions et les pré́server des tâches administratives) », détaille un communiqué que le Cese publié ce jeudi.
Reste un angle mort : le gel des fermetures de lits, troisième demande des Collectifs inter-urgences et inter-hôpitaux avec les salaires et les effectifs, sur lequel il n’y a pas de déclaration précise. « Olivier Véran a dit que les grands projets de restructuration étaient arrêtés le temps du Ségur », reprend le cardiologue. Mais quid de l’après ?