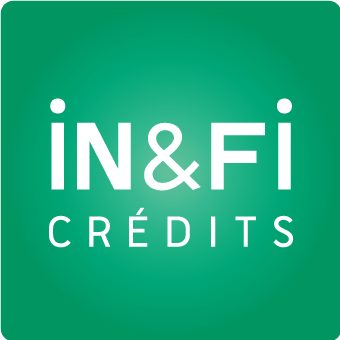Face à leur détresse et à la mort de cinq de leurs camarades depuis le début de l’année, le ministre de la Santé, Olivier Véran les rencontrera une heure ce mardi avec tous les autres étudiants de santé.
Ils s’appelaient Valentin, Tristan, Quentin, Florian… Tous étaient internes et se sont donné la mort depuis le début de l’année 2021, épuisés par leur condition de travail. «Un interne, ce sont des journées sans fin, deux gardes de 24 heures par semaine et une pression de dingue car on a la vie des gens entre nos mains», témoigne Quitterie*, interne en pédiatrie à Lille.
Depuis cinq ans, elle arpente jour et nuit les couloirs blanchâtres du CHU lillois, voguant tous les six mois entre les services de réanimation, les urgences et la pédiatrie générale. Si elle a «tenu bon», c’est grâce à ses amis et sa famille mais plusieurs fois, elle a «hésité à tout arrêter». «Je ne dormais plus, j’étais en permanence épuisée, je n’avais plus le goût de rien».
Comme elle, sur 30.000 internes en France, ils sont plus de 66 % à présenter des signes anxieux, 28% des symptômes de dépression, 26% des idées suicidaires, selon l’étude de l’Intersyndicale nationale des Internes (INSI) de 2017. «Un chiffre encore plus élevé avec l’arrivée de la pandémie», complète auprès du Figaro Gaëtan Casanova, président du syndicat et interne en anesthésie-réanimation à Paris.
Une situation face à laquelle la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a réagi dans la journée constatant que «ces situations de mal-être perdurent et que la parole peine à se libérer». Pour lutter contre cette omerta, elle appelle tous les directeurs d’ARS, les directeurs d’université de prendre des mesures adéquates quitte à «suspendre un terrain de stage où des actes de maltraitances ont été observées».
Le ministre de la Santé tiendra de son côté une réunion de concertation avec l’ensemble des étudiants de santé ce mardi 18 mai à 20 heures. Olivier Véran devra répondre à une horde d’étudiants déjà épuisés, fragilisés par la crise. «On ne veut pas d’un coup de com’, il y a de vraies questions, de vrais problèmes qui sont le reflet d’un hôpital à bout de souffle», défend Gaëtan Casanova.
Épuisement physique et moral
«Je suis toujours fatiguée, souffle Angélique*, interne en réanimation à Nice. Je travaille plus de dix heures par jour, parfois sans pause déjeuner.» L’étudiante de 26 ans a choisi cette spécialité par passion, mais elle ne «s’attendait pas à ce que ce soit si difficile». Journées de travail sans fin, gardes de 24 heures, stress permanent…
Depuis presque six ans, elle «n’arrête pas». Les semaines s’enchaînent, les nuits s’écourtent et ses vacances s’annulent. Elle se souvient de cette semaine du mois de février durant laquelle elle a dépassé les 80 heures de présence à l’hôpital. «J’ai enchaîné les blocs, les intubations, les soins, les comptes-rendus, égrène-t-elle. J’arrivais à l’hôpital, il faisait nuit, je repartais, il faisait nuit». Un épuisement qui se ressent non seulement dans ces services de soins intensifs, boudés ces dernières semaines en raison de la pandémie, mais aussi dans les autres étages des hôpitaux.
D’après une étude de l’INSI datant de 2020, les internes sont très loin d’effectuer les 48 heures hebdomadaires réglementaires mais dépassent les 58 heures, voire 90 heures pour certaines spécialités comme les chirurgiens. «Il faut que cette limite soit respectée, demande Gaëtan Casanova, c’est une nécessité» car «au-delà on est dangereux pour soi-même et pour les patients». Ces dernières sont souvent bafouées car «il y a du travail, du personnel absent et on n’a pas le choix».
Une pression ressentie par la majorité des internes, venue des chefs de service qui n’hésitent pas à solliciter leurs étudiants. 90% d’entre eux subissent un harcèlement moral, selon le syndicat. «Tous les jours je suis stressé, j’ai peur de mal faire, de faire une faute», se répète Théophile, interne en chirurgie. Tous les jours, le jeune Lyonnais côtoie la mort, l’angoisse, les pleurs, les annonces tragiques aux familles … Et doit y faire face seul.
Des jeunes seuls et désemparés
«On n’a pas le temps de nous écouter, de discuter de ce que l’on vit, il faut avancer», déplore l’interne en chirurgie. Face à de nombreuses responsabilités, les étudiants en médecine sont souvent appelés à prendre des décisions tout seul. «En garde, un chef reste parfois disponible mais pas toujours. J’ai déjà passé des nuits entières en étant le seul médecin présent», relate-t-il en notant qu’il est encore en formation et «ne pas tout savoir». Des supérieurs parfois insensibles aux craintes des plus jeunes qui débutent, regrette de son côté Gaëtan Casanova. «Ils répètent que c’était pire avant mais c’est faux. Si le nombre d’heures était lui plus important, la charge était moindre.»
Le président du syndicat national demande un meilleur suivi des internes et des chefs de service pour «un management plus humain». Finie la culture médicale où il est normal de se laisser faire et accepter de telles conditions de vie, «il faut que cela cesse». Et chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, espère Gaëtan Casanova. «Moins d’administratif et plus de soin» est une de ses principales requêtes. «On n’est pas contre travailler beaucoup, c’est un métier qu’on fait avec passion mais on a besoin d’être avec nos patients, de les soigner, pas d’avoir les mains dans des dossiers.»
Les internes ne sont pas les seuls à critiquer la part prise par l’administratif sur les soins. «Le malaise n’est pas propre aux jeunes, il est global dans la profession», soutient le Conseil national de l’Ordre des médecins dans son étude sur la santé des jeunes soignants. Un mal-être d’autant plus étrillé avec la pandémie qui a bouleversé l’organisation de tous les services hospitaliers, des infirmiers aux médecins en passant par internes les rendant plus vulnérables. L’INSI a donc lancé une enquête nationale pour établir avec précision les conséquences du Covid-19 sur le moral de ces étudiants. Les premiers résultats devraient être communiqués dans deux-trois semaines.
*Leurs prénoms ont été modifiés à leur demande
Source LE FIGARO.